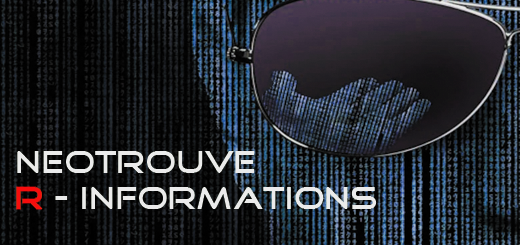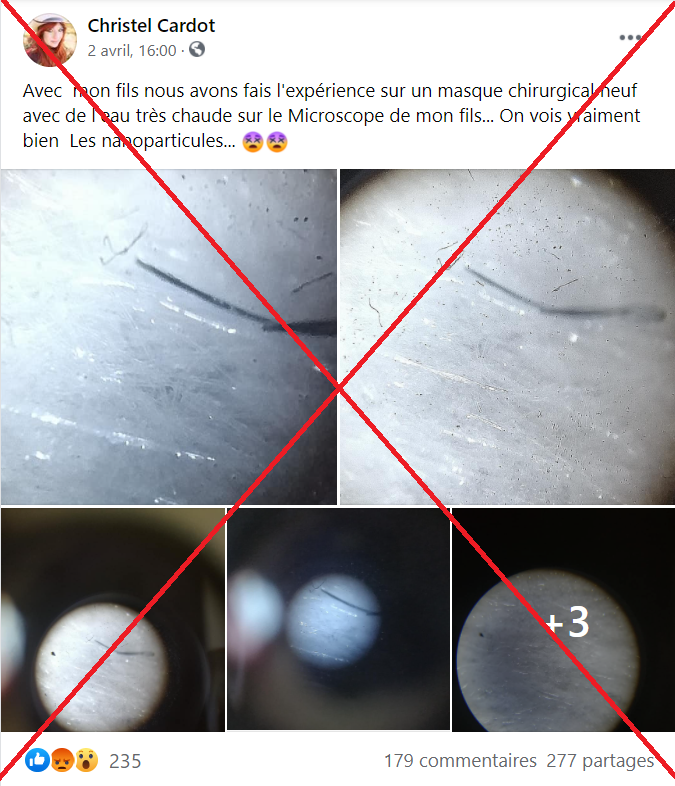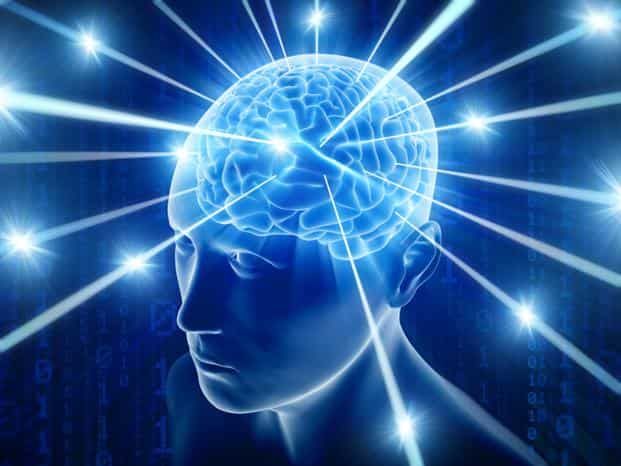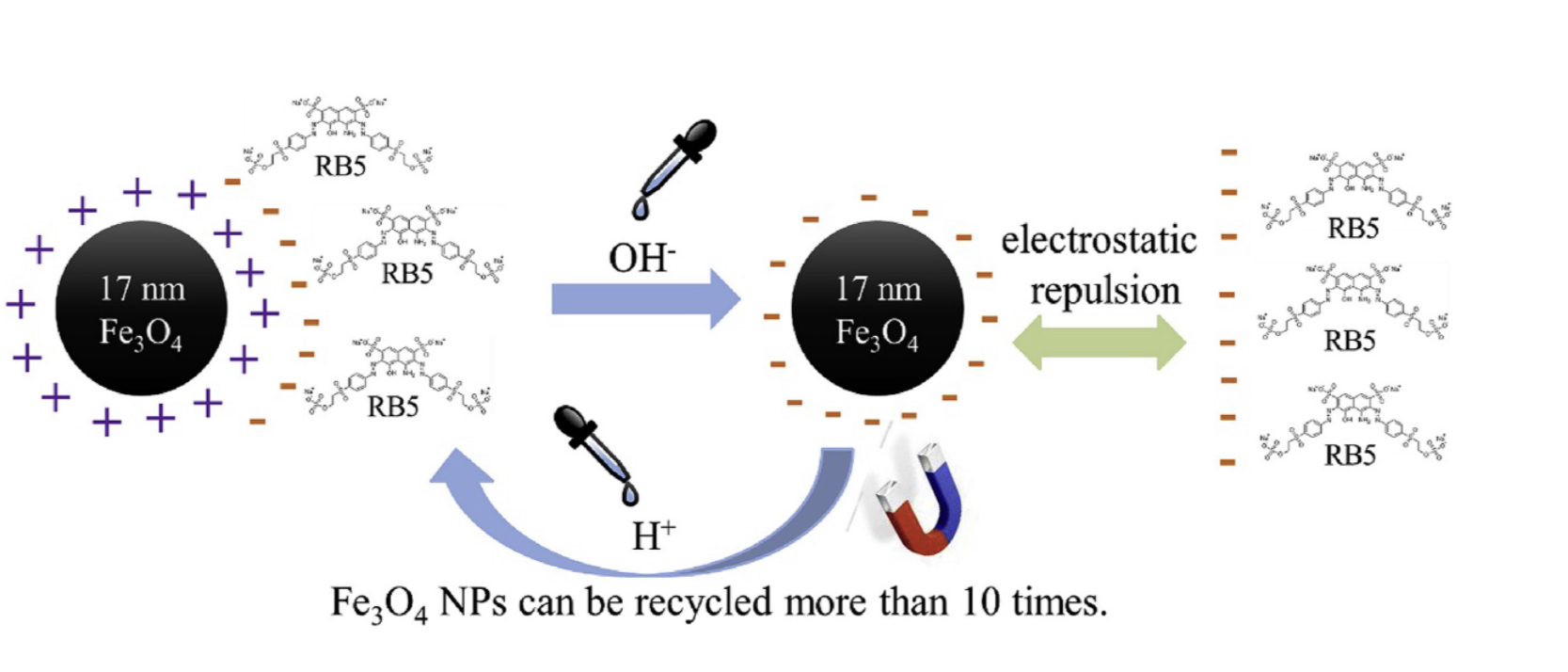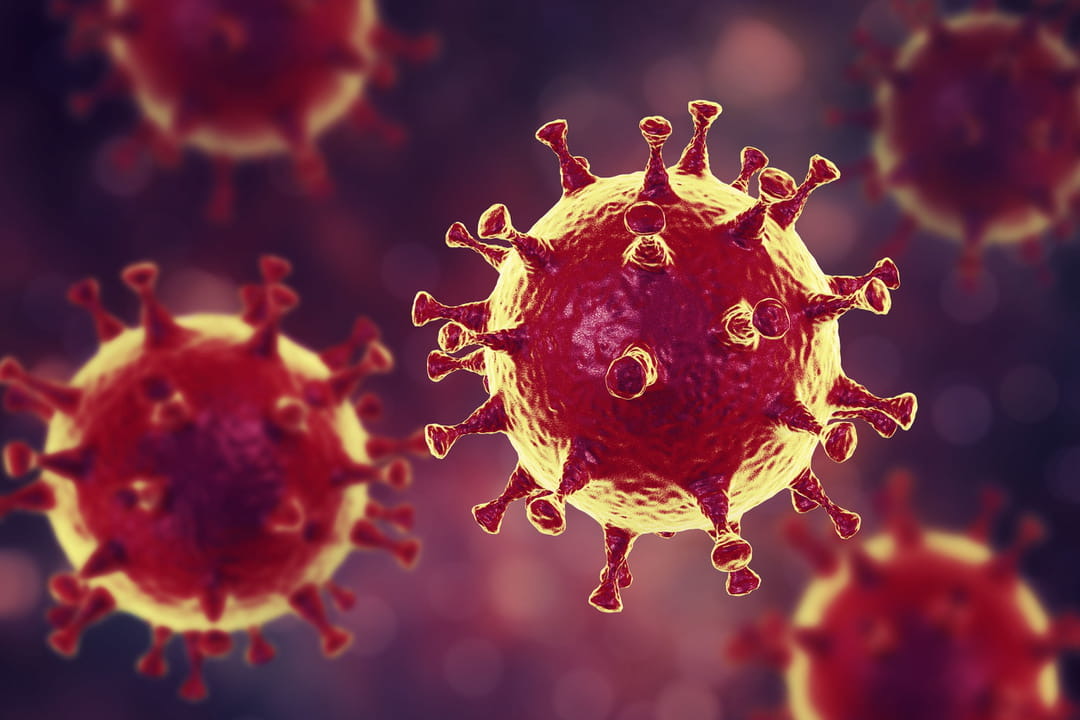Illusions cognitives : quand la neuro magie entre en scène
L’homme se détend, d’autant que le public est hilare. Mais ce n’est pas aux blagues d’Apollo Robbins qu’il réagit. Tandis que, d’une main, le magicien continue à entretenir la connivence avec sa victime et à jouer avec sa pièce de monnaie, de son autre main passée dans le dos de l’homme, il dévoile au public le portefeuille, le stylo et autres objets subtilisés dans ses poches.
Lorsqu’Apollo Robbins demande l’heure à sa victime, celle-ci s’aperçoit que sa montre a également disparu et qu’elle orne maintenant le poignet du magicien !
La scène s’est déroulée lors d’un symposium sur «la magie de la conscience» orga-nisé par la Minci Science Foundation de San Antonio (Texas, Etats-Unis). Apollo Robbins avait été invité à la suite de sa contribution à un travail de recherche paru dans le Nature Reviews Neuroscience en novembre 2008 et dirigé par Stephen Macknik et Susana Martinez-Conde du Barrow Neurological Instituts de Phoenix (Arizona, Etats-Unis).
Selon ces deux chercheurs, la magie peut nous en apprendre beaucoup sur le fonctionnement de notre cerveau. «C’est en 2006 que nous avons compris que les magiciens étaient des artistes de la cognition et de l’attention et que leurs procédés pour les manipuler étaient bien plus puissants que nos techniques scientifiques», expliquent-ils. Car un tour de magie consiste ni plus ni moins qu’à abuser notre cerveau.
Plusieurs raisons expliquent comment Apollo Robbins parvient à faire les poches de ses victimes sans qu’elles s’en aperçoivent. Ce savoir empirique s’appuie sur de véritables bases neurologiques. L’une des astuces consiste à perturber le système somatosensoriel, celui qui gère les informations en provenance de la surface de notre corps via les cellules sensitives. En serrant brièvement le poignet de la victime alors que la montre y est encore, le pick-pocket crée un contraste d’impression.
Cela rend les cellules réceptrices de la peau moins sensibles dans les secondes qui vont suivre, permettant des gestes détrousseurs très rapides et légers. Ce contact sur le poignet permet également de laisser une image somatosensorielle laissant croire à la victime que sa montre s’y trouve toujours…
Une autre astuce réside dans la pantomime des magiciens, faite de grands gestes aériens et de petits mouvements rapides.
«Pour résumer, explique Stephen Macknik, notre système visuel dispose de deux types de mouvements oculaires. Celui des saccades pour sauter d’un point à un autre lors d’un mouvement rectiligne rapide, et celui de « poursuite » pour suivre les trajectoires courbes.» En traçant des gestes larges et courbes, le magicien oblige notre système à une très forte activité neurale et à se mettre en mode «poursuite». Un bon moyen de détourner l’attention.
Autre enseignement possible, selon le chercheur: «On sait déjà que la vision est supprimée durant les saccades. Se pourrait-il que l’attention, soit également affectée ? Si c’était le cas, ce serait une découverte importante. Et démontrer qu’il est possible de contrôler l’attention et les mouvements des yeux avec des gestes en serait une autre.»
Les magiciens créent donc des illusions cognitives, qui impliquent des fonctions cérébrales de haut niveau comme l’attention mais aussi la mémoire et la conscience.
Pour Cyril Manier, du CNRS de Gif-sur-Yvette (Essonne), qui travaille sur le cortex visuel, «nos systèmes perceptifs (vision, audition, sens tactile) sont perpétuellement en train d’effectuer des inférences sur l’environ- nement dans lequel nous évoluons. Soit afin de prévoir ce qui va se passer; soit afin de pouvoir agir en temps réel, par exemple pour attraper une balle au vol. La magie vient rompre ces cohérences: ce que nous attendons ne va pas se produire. Il pourrait être utile de s’inspirer des magiciens pour mettre en œuvre des protocoles permettant d’étudier ces phénomènes. Mais la « magie » se rencontre aussi tous les jours. Par exemple, lorsque nous montons sur un escalier mécanique en panne et que nous nous apercevons que nous avons anticipé son mouvement, notre corps se trouve en déséquilibre durant quelques secondes…»
Ainsi, la magie prendrait le cerveau en défaut dans ses facultés d’anticipation. Quand le magicien fait le geste de passer une pièce de sa main droite à sa gauche en l’appuyant d’un mouvement de tête dans le même sens (voir séquence ci-dessus), notre cerveau complète l’action: nous sommes persuadés que la pièce est passée de la main droite à la gauche. Elle n’a pourtant pas bougé. La faute en reviendrait aux neurones miroirs. Ces neurones s’activent de la même manière quand nous faisons une action et quand nous la voyons faire par un autre. Ils pourraient ainsi faciliter l’apprentissage par imitation.
La magie utiliserait cette capacité des neurones miroirs à extraire l’intentionnalité des actions d’autrui en faisant croire à des actions qui ne se sont pas réellement produites.
Les magiciens ne révèlent jamais leurs secrets, dit-on. Ont-ils fait une exception pour le bénéfice de la science? «Oui, s’enthousiasme Stephen Macknik. Ils nous demandent de les garder pour nous. Mais ce sont les magiciens les plus reconnus qui sont les plus ouverts. Pour eux, l’art réside dans la performance, pas dans le secret de la méthode.»
Plusieurs projets de recherche viennent d’être mis en place par l’équipe de Stephen Macknik et Susana Martinet- Corde. En mesurant les réactions cérébrales des victimes pendant un tour de magie, ils espèrent pouvoir tirer des leçons sur le fonctionnement de notre cerveau. A cette fin, les deux chercheurs «apprennent à devenir des prestidigitateurs de haut niveau pour que les expériences soient les plus abouties possible» !
L’ABCD de notre cerveau sera-t-il un jour dévoilé par la magie ? Ce serait là un tonitruant abraca-dabra !
Source : http://www.info-sectes.ch/fonctionnement-du-cerveau.htm#memoire-implicite