La violence est elle inscrite dans les gènes ?
Selon la théorie de Howard Bloom dans son livre « le Principe de Lucifer », la violence résulte simplement du processus de la Nature qui a lieu avec l’apparition de réplicateurs tels que les gènes. Ces gènes, comme les ressources sont limitées, entrent en collision, et les individus qui portent ces gènes luttent pour augmenter la reproduction de leurs gènes. En termes « gèno-centrés », cela revient à dire que les gènes produisant les êtres les plus violents, ont augmentés leur chance de se reproduire. Mais cette sélection ne s’effectue pas au niveau individuel mais au niveau du groupe. Ce sont les groupes qui sont en compétition entre eux pour survivre et surtout pour reproduire leur pool génétique.
Cette hiérarchie de dominance est à l’origine d’une grande partie de nos comportements (ça il est pas le premier à l’avoir vu), et cette dominance permet effectivement de sélectionner les meilleurs gènes. Plus exactement les gènes qui poussent à la dominance, en augmentant le niveau de testostérone par exemple, a tendance à mieux se reproduire, car il aura accès à plus de femmelles. D’autre part, les femelles choisissent plutôt les hommes à forte dominance. La rivalité féminine pour les mâles dominant concourrant elle aussi à renforcer la puissance de ce système de dominance.
Pourquoi tant de sauvagerie ? Selon Howard Bloom « La majeure partie de celle-ci naît d’un simple commandement biologique : soyez fertiles et multipliez-vous. Le gorille Effie entraîna ses amies dans le meurtre d’un bébé afin de remporter un avantage pour sa propre progéniture. Livia, maîtresse de la puissante Rome, fit de même au profit de ses fils et des fils que ceux-ci auraient. Là où la violence éclate, des enfants surgissent encore et encore. Les mâles se battent pour le droit d’en avoir. Les êtres humains déclarent des guerres pour que ceux-ci vivent dans un monde plus sûr.
Aussi étrange que cela puisse paraître, les enfants, et les gènes qu’ils portent, sont l’une des clés du mystère de la violence. Un langur gris mâle adulte qui devient le chef s’installe comme un roi au centre de son groupe. Pour de multiples raisons, il tient là un filon. Si vous observez plus en détail les groupes de langurs qui grouillent autour de lui, vous découvrirez qu’ils sont tous ses femmes ou ses enfants. Les femmes font ce qu’il leur ordonne et lui réservent leur corps. Si elles font mine d’engager une relation avec un fringant célibataire, elles sont sévèrement punies, ainsi que le séducteur ambitieux. Inutile de se demander pourquoi le mâle dominant a l’air si arrogant. Il est entouré par une tribu qui sert un seul objectif fondamental : porter et élever ses enfants. Comme nous l’avons vu dans un précédent chapitre, les membres de la société des langurs ne sont pas tous satisfaits de cet état de fait. Dans la jungle alentour rôde une bande de voyous postpubères qui ont définitivement quitté leur foyer pour traîner avec des durs de leur âge. Leurs hormones sexuelles jaillissantes ont déclenché l’augmentation de leur excitation sexuelle, de leurs muscles et une agressivité prétentieuse. Périodiquement, la bande des jeunes voyous avance sur le territoire où le vieux souverain établi se tient au milieu de sa grande famille. Les rebelles essaient d’attirer son attention. Ils raillent et provoquent le patriarche. Celui-ci reste parfois à distance, refusant d’honorer leurs sarcasmes de la moindre réponse.
A d’autres moments, il se dirige vers la périphérie du harem, puis recule et affiche une indignation qui chasse les Jeunes Turcs. Mais, de temps à autre, la bande de délinquants poursuit ses provocations, déclenchant une bagarre pouvant être extrêmement brutale. S’ils ont de la chance, ces parvenus écrasent complètement leur digne supérieur, le chassant ainsi de son confortable foyer. Puis les membres triomphants de la jeune génération commettent une atrocité. Ils se jettent sur les femelles qui hurlent et saisissent les bébés dans tous les sens. Ils balancent les bébés contre les arbres, les jettent par terre et leur écrasent le crâne. Ils tuent encore et encore. Lorsque l’orgie assoiffée de sang s’achève, il ne reste plus un seul petit. Pourtant, les femelles en pleine maturité sexuelle ont toutes été épargnées. Cette tuerie est tout sauf un hasard. Comme l’infanticide d’Effie, c’est un simple objectif. Ce groupe de femmes élevait les enfants du vieux mâle qui venait de fuir.
Tant que les femelles continueraient à allaiter des enfants, les nouveaux maîtres seraient liés aux enfants de l’ancienne autorité renversée. Un outil de contraception naturel nommé aménorrhée lactationnelle entretiendrait leur désintérêt pour le sexe, ce qui les empêcherait d’avoir leurs chaleurs9 et donc de porter la semence des nouveaux conquérants. Lorsque le bébé d’une mère est tué et que l’allaitement est stoppé, par contre, le jeu change du tout au tout. La biochimie de la femelle est modifiée, ce qui ressuscite son intérêt pour le sexe.
Elle devient un ventre vide attendant d’avoir un nouvel enfant. Et cet enfant n’appartiendra pas au monarque déchu mais portera l’héritage de l’un des envahisseurs. Mais les êtres humains ne s’abandonnent certainement pas à ce genre de barbarerie. Quoique. Dans les forêts tropicales humides d’Amazonie vit un peuple nommé les Yanomamo. Leur ethnographe, Napoleon Chagnon, les appelle le « peuple féroce ». Ils s’enorgueillissent de leur cruauté, la glorifiant avec un tel enthousiasme qu’ils font un vrai spectacle des raclées qu’ils infligent à leurs femmes. Et les femmes prennent part à cette brutalité tout autant que leurs maris. Une épouse qui ne porte pas assez de cicatrices des coups de son mari se sent rejetée et se plaint pitoyablement de ce manque de meurtrissures. C’est le signe, pense-t-elle, que son mari ne l’aime pas.
Les hommes Yanomamo ont deux grandes préoccupations : la chasse et la guerre. Le type de guerre qu’ils pratiquent ressemble étrangement à celle des langurs. Les hommes Yanomamo se glissent dans un village voisin et attaquent. S’ils sont victorieux, ils tuent ou chassent les hommes.
Ils épargnent les femmes en âge de procréer, mais passent méthodiquement de maison en maison, arrachant les enfants des bras de leurs captives qui hurlent. Comme les langurs, les hommes Yanomamo cognent ces enfants contre la terre, leur explosent le crâne sur des pierres et inondent le chemin du sang de ces bébés. Ils transpercent de la pointe de leur arc les enfants les plus vieux, clouant leur corps au sol. Ils jettent simplement les autres du haut d’une falaise. Pour les Yanomamo, c’est un amusement hilarant. Ils se vantent et se glorifient tout en écrasant des nouveaunés contre les pierres. Lorsque les guerriers vainqueurs en ont terminé, il ne reste plus un seul nourrisson. Puis les hommes Yanomamo emmènent les femmes capturées vers une nouvelle vie de deuxième épouse.11 Inutile de se demander pourquoi le mot Yanomamo pour se marier est « emmener quelque chose en le traînant ». Qu’ont accompli les vainqueurs Yanomamo ?
La même chose que les langurs. Ils ont libéré les femelles de leur mécanisme de contraception biochimique qui empêche les femmes allaitantes de porter un nouvel enfant. Les combattants Yanomamo ont rendu le ventre des épouses capturées libre de porter leurs enfants. Les Yanomamo ne sont pas une étrange aberration sortie de la jungle pour illustrer une idée venant de loin. Au début du quatrième siècle, Eusèbe, premier historien de l’Eglise Chrétienne, résuma ce sur quoi l’étude de l’histoire s’était penchée jusqu’à son époque : la guerre, les tueries au nom de la nation et des enfants. Hugo Grotius publia en 1625 De Jure Bellis ac Pacis ou A propos des lois de la guerre et de la paix, livre qui tentait de rendre la guerre chrétienne plus humaine. Dans cet ouvrage, Grotius justifiait les infanticides. Il citait le psaume 137, qui dit, « Heureux qui saisira et brisera tes petits contre le roc ». Ainsi, Grotius était conscient de deux choses : que tuer les enfants de l’ennemi était une chose courante à l’époque du Nouveau Testament et que cela l’était tout autant au dix-septième siècle.
En fait, les efforts impatients des mâles humains pour trouver plus de ventres pour porter leur semence ont été glorifiés par les ancêtres de la civilisation occidentale. Le viol des Sabines, passage de l’histoire romaine que toute personne ayant un peu de culture classique peut conter, était un coup monté semblable à ceux que réussissent fréquemment les Yanomamo.
Les héros de l’histoire, un groupe des premiers Romains, invitèrent les hommes de la tribu voisine et leurs femmes pour un dîner et des divertissements. Les divertissements s’avérèrent être des armes romaines. Les hôtes tirèrent leurs épées, attrapèrent les jeunes femmes puis attaquèrent et chassèrent leurs époux. Les pères fondateurs de Rome passèrent ensuite un bon moment puisqu’ils se mirent joyeusement à violer leurs captives en sanglots.
Et neuf mois plus tard, il y eut d’autres sanglots lorsque les femmes kidnappées mirent au monde un grand nombre de bébés romains, ceux de leurs hôtes du banquet.15 La Guerre de Troie se termina également par une scène que tout guerrier Yanomamo aurait comprise.
Elle commença par une bataille à propos d’une femme, une superbe créature qui agissait comme la cane de Konrad Lorenz, la femelle aquatique qui provoquait une bagarre puis revenait vers son partenaire en essayant de la pousser dans la bataille.
L’instigatrice, dans le cas du conflit humain, était Hélène. Lorsque les combats prirent fin, les Grecs vainqueurs furent récompensés par un trésor Yanomamoesque : un butin et les Troyennes qu’ils avaient conquises. Les guerriers emmenèrent les femmes chez eux et les violèrent, mais ne s’embarrassèrent pas des enfants troyens sur le chemin du retour. (Alors que Troie subissait la défaite, Andromaque, l’une des épouses troyennes, expliqua à son enfant ce qui risquait de lui arriver : « l’un des Achéens te jettera, t’ayant empoigné, du haut des murailles – triste fin ! ») Moins d’un an plus tard, les bébés des prisonnières troyennes vinrent agrandir la descendance grecque. 17 Les Yanomamo, les langurs gris, les Romains et les Grecs furent tous menés par la même force. Ils avaient soif de sexe et cette soif traduisait autre chose : leur désir de peupler le monde de leurs propres descendants. Mais les hommes ne sont pas les seuls ; Effie le gorille cannibale et Livia la conspiratrice romaine voulaient la même chose. Derrière ces pulsions violentes se cache le simple désir d’avoir des enfants. Ce qui nous amène à l’une des forces fondamentales du Principe de Lucifer : l’avidité des gènes. »
Le propos d’Howard Bloom s’oppose radicalement à la Déclaration de Séville qui affirme que la violence n’est ni dans les gènes ni dans l’évolution humaine. Tout au contraire, ce livre démontre que l’être humain est un remarquable prédateur, que la violence est inhérente à sa survie, que seule la prise en compte de ce facteur essentiel peut permettre l’apparition de sociétés plus harmonieuses. Religions, politiques, philosophies, droits ont tous échoué à façonner une société respectueuse de la vie, tous se sont fondés sur une vision idéalisée de l’humain. Howard Bloom propose de connaître l’humain tel qu’il est, alors peut-être autre chose pourra être établi.
La thèse d’Howard Bloom se développe autour de deux axes, celui des gènes et celui des mèmes. La nature utilise l’humain comme véhicule des gènes et laboratoire d’essai pour l’évolution, la mutation ou l’élimination de ces derniers. Nous sommes donc » vécus » par nos gènes, mais la notion la plus intéressante est celle des mèmes :
» Les gènes qui n’arrivent pas à fonctionner correctement avec leurs partenaires sur la chaîne chromosomique sont condamnés. La merveille auto-réplicante que nous allons rencontrer est également obligée de s’intégrer dans une constellation de ses congénères, faute de quoi elle aussi disparaît.
Quel est ce nouveau venu dans le domaine de l’autoscopie ? Il n’a pas de substance physique, et ne peut être observé au microscope ou dans un bocal. Le nouveau réplicateur, comme son prédécesseur le gène, est capable d’assembler de grandes quantités de matière. Comme les gènes, il peut réunir des produits que la terre n’a jamais vus, mais, au contraire, des gènes il peut fabriquer des formes d’ordre dont les simples objets génétiques n’auraient jamais pu rêver.(…)
Les gènes, affirme Dawkins, nageaient dans la soupe protoplasmique de la Terre, se nourrissant de boue organique. Les mèmes flottaient dans une autre sorte de mer : une mer de cerveaux humains. Les mèmes sont les idées, les fragments de néant qui vont d’esprit en esprit. Une mélodie monte dans les rêveries d’un compositeur solitaire. Elle s’empare du cerveau du chanteur. Puis elle infecte la conscience de millions de personne. Cette mélodie est un même. Un concept philosophique naît comme une lueur vague dans les pensées d’un chercheur. Il finit par avoir des écoles entières de partisans. Ce concept est un même. Chacun d’entre eux saute d’un cerveau à un autre, se copiant frénétiquement dans le nouvel environnement. Mais les mèmes qui comptent le plus sont ceux qui assemblent de grandes quantités de ressources pour en faire de nouvelles formes stupéfiantes. Ce sont les mèmes qui construisent les superorganismes sociaux.
Les gènes se situent au centre de chaque cellule, maîtres d’œuvre de la construction d’un corps, tel que le vôtre ou le mien, composé de plusieurs milliards de cellules. Les mèmes sont au superorganisme ce que les gènes sont à l’organisme : ils rassemblent des millions d’individus dans une créature collective d’une taille impressionnante. Les mèmes étirent leurs vrilles dans le tissu de chaque cerveau humain, nous amenant ainsi à nous coaguler en ces masses coopératives que sont la famille, la tribu et la nation. Et les mèmes, en travaillant ensemble dans les théories, les visions du monde et les cultures, peuvent rendre un superorganisme très affamé. »
Gènes et mèmes sont à l’origine des luttes pour le pouvoir, le territoire et la reproduction qui sont à l’œuvre derrière nos beaux discours. Sous le masque des belles histoires nées de l’activité du néo-cortex, les anciens cortex restent à l’œuvre…
Bloom en tire une conception du monde assez intéressante :
» Les systèmes que je vais décrire ne sont pas mon idée de ce que devrait être le monde, ils sont les conclusions auxquelles j’ai abouti à regret, concernant ce qu’il est vraiment. « . « Il traite de la façon dont, par notre intérêt pour le sexe, notre soumission à des dieux et à des dirigeants, notre attachement parfois suicidaire à des idées, des religions et de vulgaires détails de type culturel, nous devenons les instigateurs inconscients des exploits de l’organisme social. »
-Le principe des systèmes auto-organisateurs, c’est-à-dire des » réplicateurs » qui fonctionnent comme des mini-usines fabricant des « produits jetables « … comme vous et moi…
-Le super organisme : nous ne sommes que des pièces de remplacement d’un être beaucoup plus important que nous.
-Le mème : un noyau d’idées auto-répliquant qui devient le ciment qui rassemble les civilisations.
-Le réseau neuronal qui nous transforme en composants d’une immense machine à apprendre.
-L’ordre de préséance, principe majeur de l’histoire -dont le mouvement est incessant- assurant l’ascension des uns et le déclin des autres, dans une gigantesque compétition darwinienne dont les mèmes sont les infatigables moteurs.
1) Rôle et origine des mèmes
L’auteur fait sienne la description de Dawkins, qui ne manque pas de vigueur : « les gènes nageaient dans la soupe protoplasmique de la Terre, se nourrissaient de boue organique. Les mèmes flottaient dans une autre sorte de mer : une mer de cerveaux humains. Les mêmes sont des idées, les fragments de néant qui vont d’esprit en esprit… »
Howard Bloom complète cette description : « chaque même [mélodie, concept scientifique, croyance, idée politique] saute d’un cerveau à un autre, se copiant frénétiquement dans le nouvel environnement. Mais les mèmes qui comptent le plus sont ceux qui assemblent de grandes quantités de ressources pour en faire de nouvelles formes stupéfiantes. Ce sont les mèmes qui construisent les superorganismes sociaux… Les mèmes sont aux superorganismes ce que les gènes sont à l’organisme… Les mèmes étirent leurs vrilles dans le tissu de chaque cerveau humain, nous amenant ainsi à nous coaguler en ces masses coopératives que sont les familles, les tribus et les nations. Et les mèmes, travaillant ensemble dans les théories, les visions du monde et les cultures, peuvent rendre un superorganisme tres affamé ».
Ce thème de la « gloutonnerie » et de l’avidité des superorganismes est un thème récurrent ici, expliquant ainsi l’âpreté et la violence de la compétition entre superorganismes. Le mème est la base du « régime alimentaire » du superorganisme : iil vit, se développe, résiste, conquiert, domine grâce à lui.
Les mèmes : une propagation très aléatoires
Pour l’auteur, la supériorité des mèmes sur les gènes, c’est leur capacité, et surtout leur rapidité de propagation, infiniment supérieure à celle des gènes qui est plus lente, plus régulière mais à terme assurée d’aboutir. Il n’en va pas ainsi des mèmes qui peuvent, bien que parfaitement conçus et élaborés dans un cerveau isolé, ne jamais émerger, ou, à tout le moins, le faire avec une extrême difficulté et de très longs délais de maturation. Mais, à la différence du gène, une fois l’émergence assurée, la propagation peut être fulgurante.
L’histoire implique selon Bloom une dissociation progressive des gènes et des mèmes
Si comme le dit Dawkins, les gènes sont « égoïstes » (selfish genes), les mèmes, eux, sont « sûrs d’eux-mêmes » et capables de couper les liens quasi biologiques qui les unissent aux gènes. Progressivement, « conscients » de la suprématie que leur apportent leur extrême complexité, leur entraînement à toutes les formes de combat, ils finissent par trouver les gènes trop « encombrants », ils s’en séparent.
A un moment de l’histoire de l’humanité, les mèmes se séparent des gènes. A l’origine en effet, il existe une forte coïncidence, entre ces communautés génétiques de base que sont la famille ou la tribu, et l’ensemble des mèmes qui expriment leur identité par des « marqueurs » socio-génétiques : attitudes, signes de reconnaissance, langages, habitudes vestimentaires, pratiques de solidarité et d’échange, sentiment religieux et vénération d’un dieu ou d’une divinité particulière. Howard Bloom montre que ces grands conquérants militaires et spirituels que furent Bouddha, Alexandre, Paul de Tarse… n’ont eu de cesse en investissant les esprits, en propageant leurs idées de permettre aux mèmes de quitter leurs niches génétiques d’origine pour se développer, s’enrichir, se transformer et tenter de conquérir le vaste monde.
En 500 avant notre ère, Bouddha fut sans doute l’un des premiers à engager ce processus de séparation entre génétique et mémétique.
Deux siècles plus tard, Alexandre emmène les idées hellénistiques dans les anciens empires de Perse, d’Egypte et d’Inde, sautant par dessus les barrières génétiques.
Mais c’est l’exemple de Paul qui frappe le plus. En effet, l’environnement mémétique de Saint Paul est complètement différent de celui des apôtres. C’est un urbain, fils de citoyen romain, ayant fait de hautes études et s’exprimant dans la langue de l’élite internationale : le Grec. Dès le début, il rencontre des difficultés avec le monde galiléen traditionnel auquel appartiennent Jésus et ses disciples restés très proches de leur communauté d’origine.
Confronté à cette situation, « il entame une campagne mémétique vigoureuse pour rallier les « gentils », des Grecs, des Romains, des Anatoliens, des Siciliens, des Espagnols. Au cours de cette campagne, Paul fut l’un des créateurs d’un nouveau concept : la religion transmissible. Il la libère de l’ancienne notion selon laquelle un dieu était un emblème de l’héritage tribal et tranche les liens qui attachent la divinité aux gènes. « Grâce à Paul, le mème chrétien allait rassembler un mélange incroyable de gènes. Les gènes grecs et romains aux cheveux foncés, les gènes scandinaves aux yeux bleus et aux cheveux blonds, les gènes africains à la peau noire, et même quelques gènes chinois et japonais. Des gènes dont les hélices génétiques étaient tellement différentes se retrouvèrent réunis par un fil commun. Ce lien impalpable était un nouveau même « .
Ainsi l’évolution de la culture judéo-chrétienne de l’Ancien Testament (pour lequel les filiations génétiques ont une grande importance) au Nouveau, et ce jusqu’à nos jours, se traduit par un enrichissement mémétique continu(2).
Cette incursion dans l’histoire et la sociologie des religions, du bouddhisme au judéo-christianisme, montre à quel point la mémétique peut devenir un système très puissant de compréhension des sociétés et de leur évolution.
La compréhension mémétique des facteurs religieux et culturels est certainement l’un des grands enjeux de notre époque, et le moyen d’éviter que le « choc des civilisations » annoncé non sans raison par Huntington comme caractérisant les temps à venir, ne dégénère pas en conflit planétaire. Là encore, l’exigence de lucidité appuyée sur une rigoureuse analyse scientifique doit précéder et préparer toute recherche et tout discours crédible sur la paix et l’évolution du monde.
Nous venons de voir à quel point les gènes et surtout les mèmes constituent la substance des superorganismes, et l’énergie nécessaire à leur survie et à leur expansion. Suivons maintenant Howard Bloom dans la description de l’architecture en réseau qui permet au superorganisme de se construire et de maîtriser en son sein l’agitation permanente et parfois brouillonne des mèmes.
Ce qui permet au superorganisme de réguler cette agitation incessante des mèmes, c’est le développement en son sein d’un réseau neuronal. Ce réseau, comme le cerveau humain nous dit Bloom, peut interférer avec un monde invisible à partir de parcelles d’information visibles. « Ce sont en fait les mécanismes imprécis qui nous donnent parfois le contrôle de la réalité ».
C’est le réseau neuronal qui donne aux hommes la capacité de maîtriser le flou et l’incertain qui dessinent l’horizon des sociétés humaines. H. Bloom conçoit la société comme un réseau neuronal : « une société est un cerveau, un outil d’apprentissage qui fonctionne selon les principes qui dirigent un réseau neuronal . (…) Les interactions qui donnent au groupe social ses formes, la toile invisible de connexions qui réunit une société, le réseau de structures qui crée une culture, sont des formes dont le pouvoir transcende l’existence de chaque individu. Elles forment l’âme du superorganisme social.
L’évolution n’est pas seulement une compétition entre individus. C’est une compétition entre réseaux, entre toiles, entre les âmes des groupes « .
Lorsque le Japon et les Etats-Unis luttent pour la suprématie économique, lorsque les Croisés partent défier l’Empire Islamique, ou même lorsque des groupes rivaux de Gardes Rouges s’affrontent, la lutte n’est pas une lutte d’hommes mais un lutte de réseaux de machines à apprendre liées par des mèmes, testant leurs formes les unes contre les autres. En se basant sur une histoire pleine de ce type de conflits, les vastes toiles et les réseaux invisibles se dressent encore plus haut dans une immense stratosphère de formes, précipitant le monde vers sa destination, un avenir toujours plus complexe ».
Cette montée vers la complexité ne se fait pas sans luttes incessantes pour assurer une préséance toujours temporaire car menacée à peine acquise. Ce combat sans fin assure la montée vers la complexité. « Le superorganisme, les idées et l’ordre de préséance : telles sont les principales forces qui résident derrière la créativité humaine. Elles sont la seule trinité du Principe de Lucifer »
Pour finir, Bloom essaie de montrer que toute la construction mentale que les hommes (et notamment les grandes religions révélées) ont édifiée autour de la notion de Mal, est en fait une projection de certains mouvements intérieurs que nous avons en nous depuis l’aube des temps et que nous refusons de voir. Ce sont des appétits, des pulsions, des règles de préséance et des jeux de pouvoir, ou encore, ce que la critique de Jean-Caude Empereur souligne bien, des conflits mémétiques entre sous-cultures se battant pour le contrôle d’un ou plusieurs groupes humains. Ces monstres cachés sont pourtant inhérents au fonctionnement intime du monde biologique et du monde social.
Ainsi, Bloom montre comment on fabrique un ennemi pour l’accuser de tous les vices que l’on ne veut pas regarder au fond de soi. L’ennemi ultime qui nous dédouane de toutes nos culpabilités, c’est Lucifer. Le mème de Lucifer trouve sa ressource de propagation et de conquête des esprits dans la dissimulation, résultant (c’est moi qui le rajoute), de l’empilement des mèmes culturels qui visent depuis longtemps à nous distinguer de l’animal.
Sites et blogs consultés :
www.lejardindeslivres.com : Le principe de Lucifer Howard Bloom
traduction française de The Lucifer Principle
Le jardin des Livres, Editeur (2001)
www.admiroutes.asso.fr : la revue Publiscopie : Notes par Jean-Claude Empereur
www.visionsintegrales.com

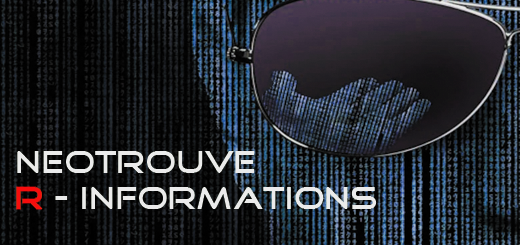

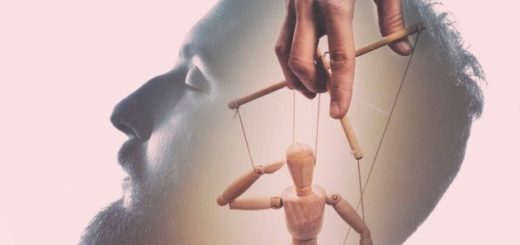




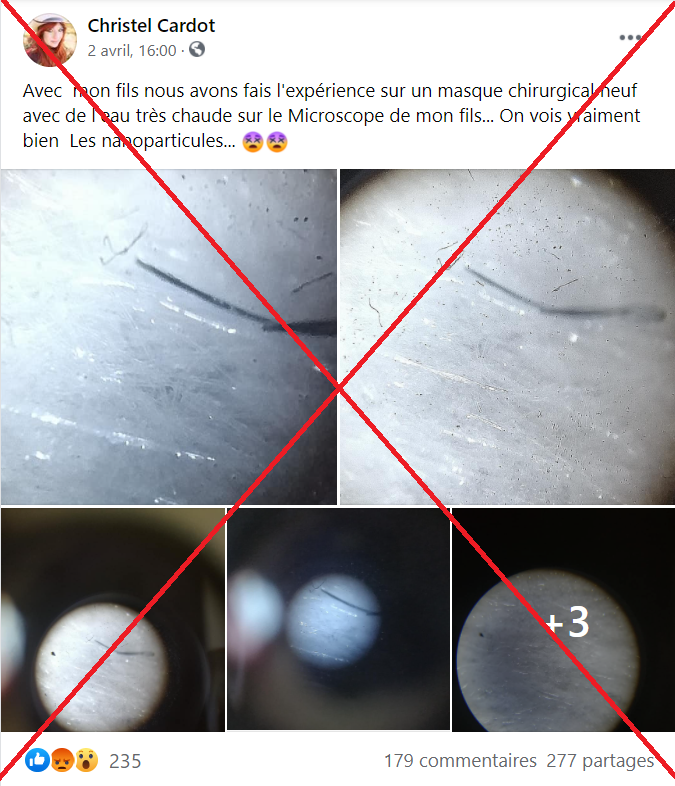
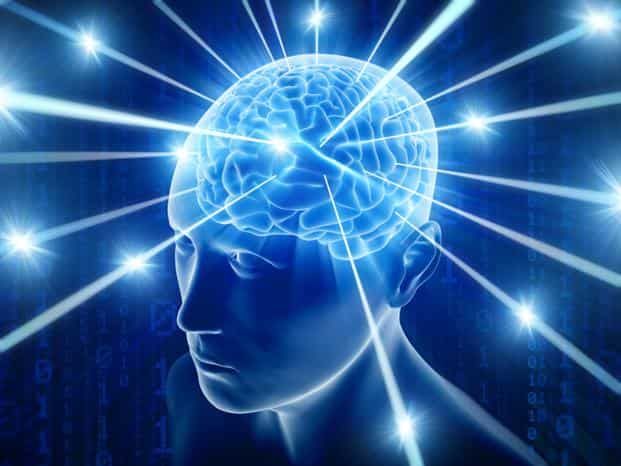


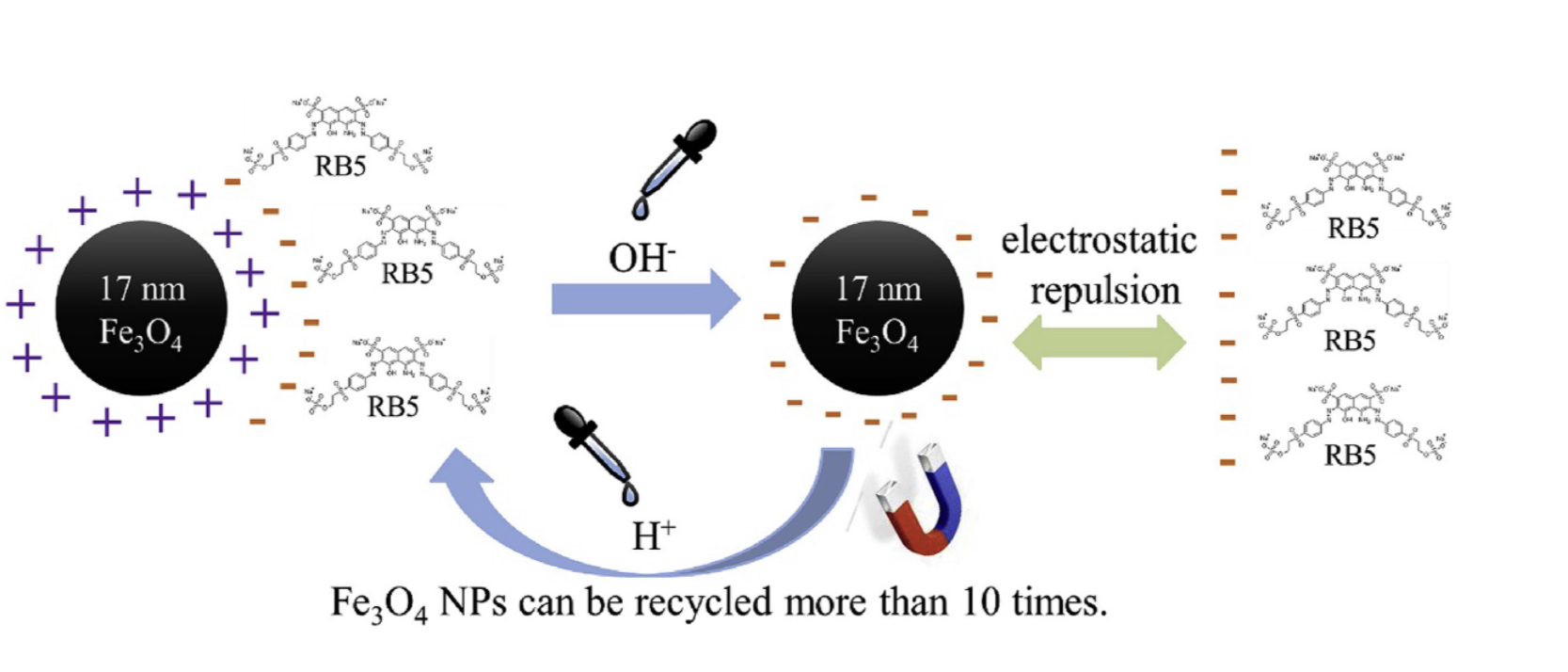


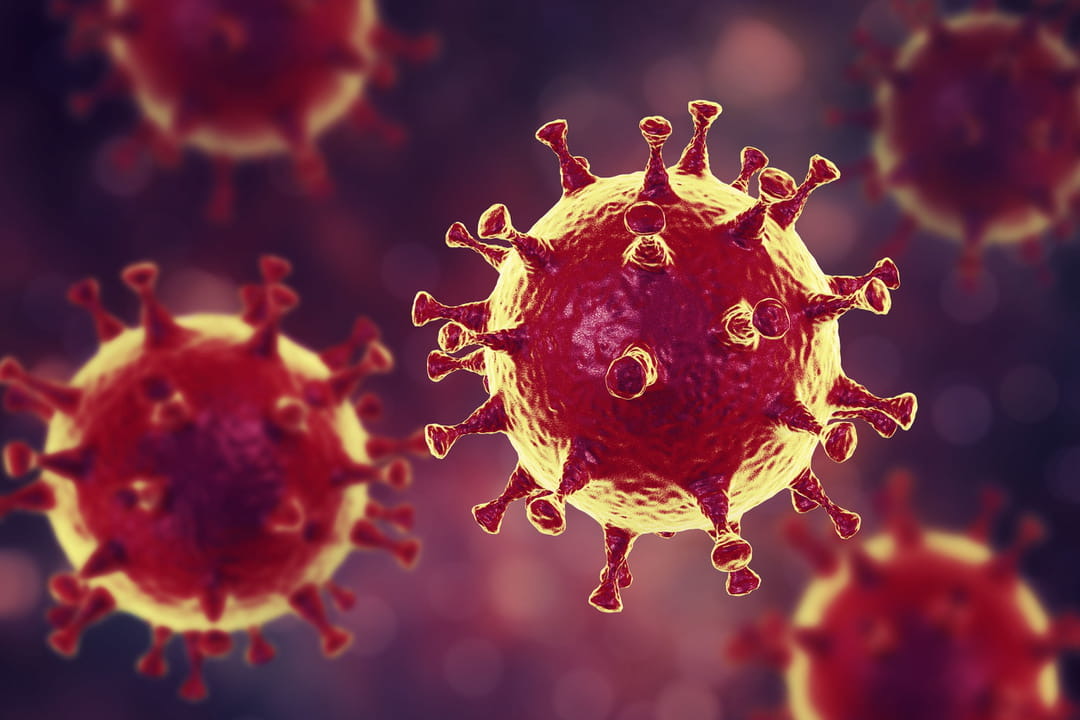

1 réponse
[…] La violence est elle inscrite dans les gènes ? […]