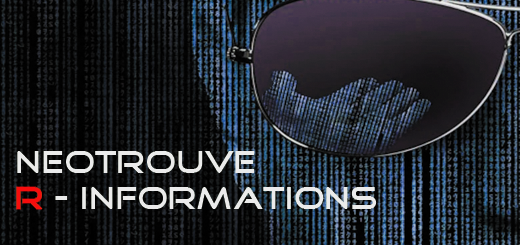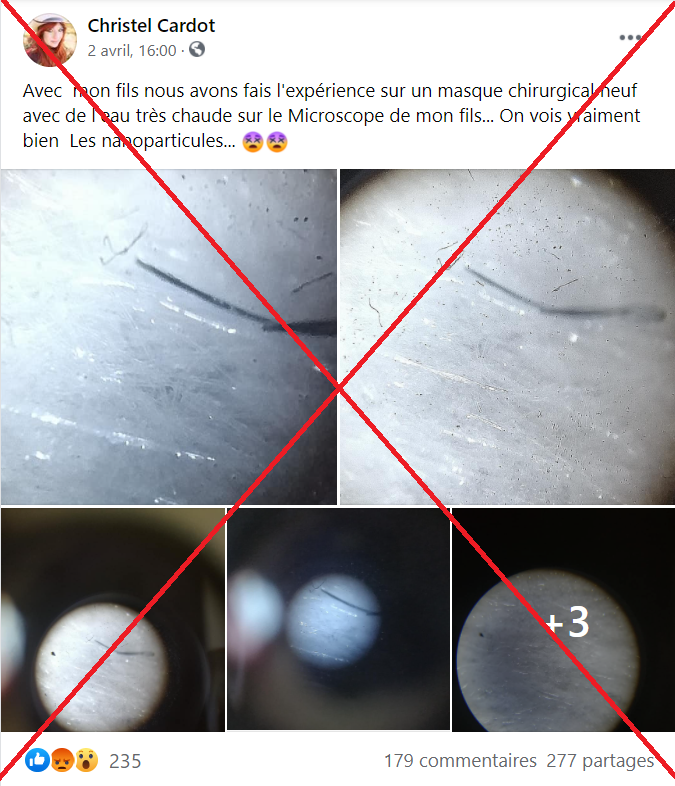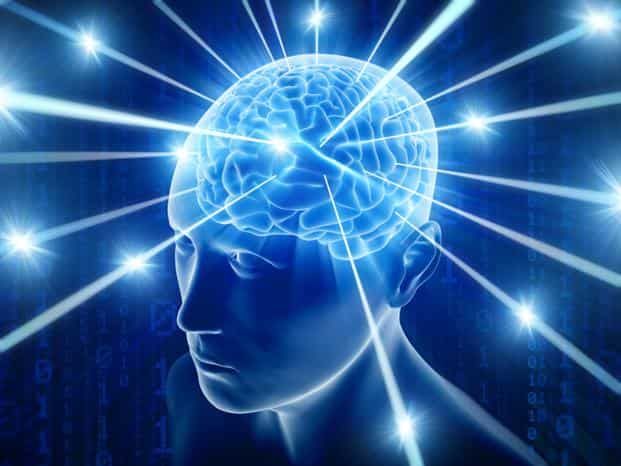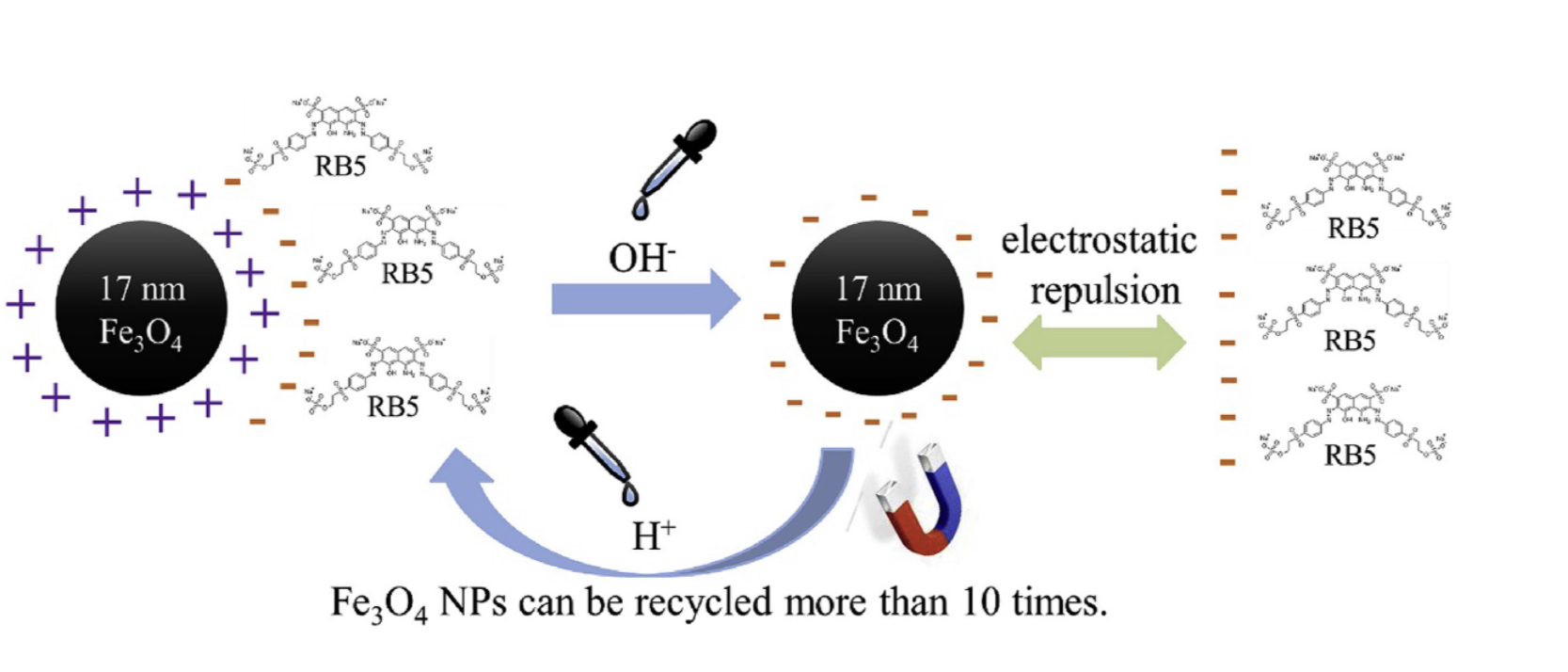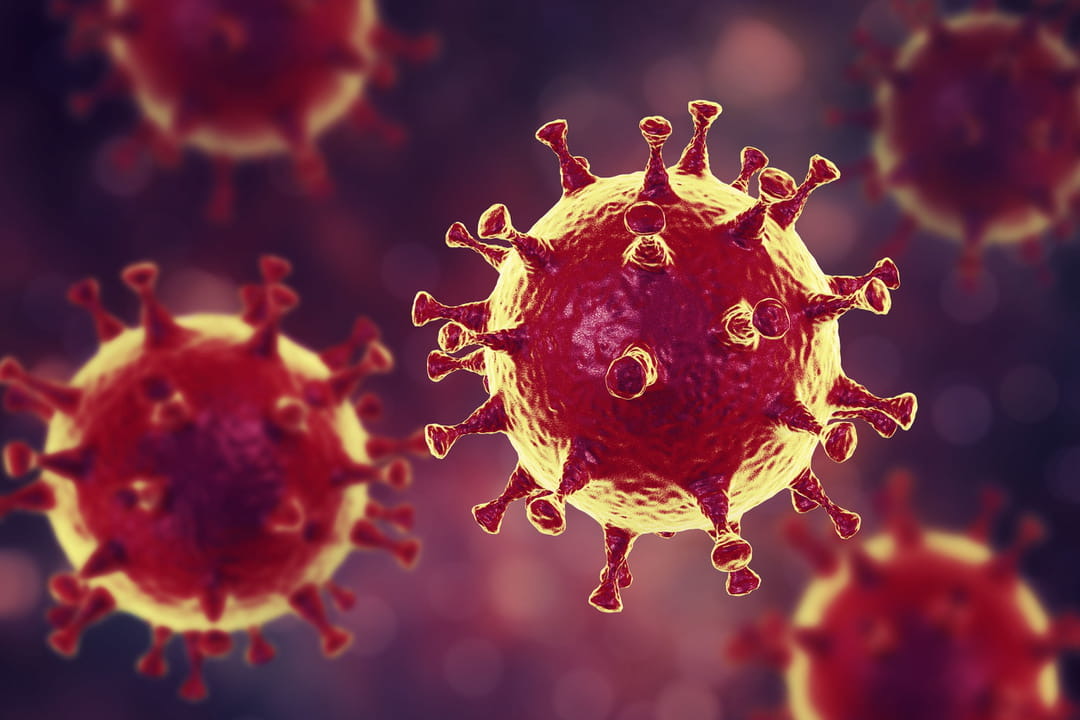Illusion de la « pensée positive » et mythe du contrôle
La théorie de la pensée positive repose sur l‘idée que notre vie est le simple reflet de nos pensées : en les contrôlant, on pourrait avoir tout ce que l’on désire. Nos difficultés viendraient donc du fait que nous pensons négativement. La solution apportée par la pensée positive est donc de contrôler les émotions et pensées négatives, de les supprimer et de ne plus avoir que des pensées positives, afin de diriger notre vie vers la réussite et le bonheur.
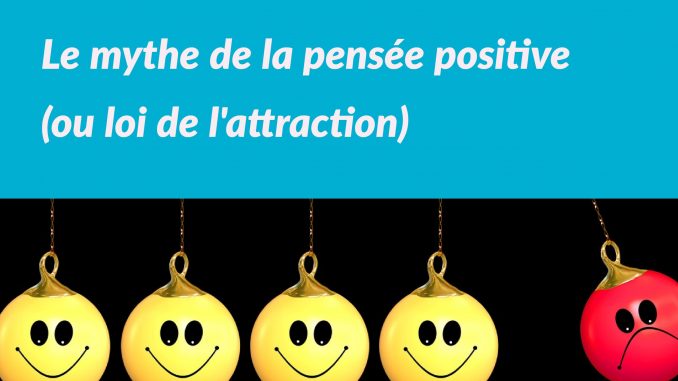
Les pensées positives peuvent en effet produire des émotions positives (et encore, pas systématiquement) mais , comme le rappelle justement Matthieu Ricard, “l’univers n’est pas à notre disposition”. Par ailleurs, pouvons-nous véritablement contrôler nos pensées ?
Ilios Kotsou propose dans son livre Éloge de la lucidité de déconstruire la théorie de la pensée positive et le mythe de la loi de l’attraction en s’appuyant sur des études de psychologie et de neurosciences.
Le mythe du contrôle
Ilios Kotsou soutient que pouvoir se débarrasser de pensées inconfortables, dites “négatives”, et les remplacer par des agréables, dites “positives” n’est pas aussi évident que cela.
Ilios Kotsou cite l’expérience de Daniel Wegner, professeur de psychologie à Harvard, au cours de laquelle il a demandé à des individus de décrire verbalement ce qui leur passait par la tête pendant cinq minutes après qu’on leur ait donné la consigne de ne pas penser à un ours blanc. Ces individus étaient repartis en deux groupes :
- dans le premier groupe, les individus devaient essayer, tout en continuant de décrire ce qui leur traversait l’esprit, de ne pas penser à un ours blanc (chaque fois qu’ils pensaient à un ours blanc, ils devaient appuyer sur un bouton); ensuite, pendant un temps supplémentaire de cinq minutes, on leur demandait de faire le contraire et de penser à un ours blanc.
- dans le deuxième groupe, la consigne était inversée (on demandait aux individus d’abord de penser à un ours blanc puis de ne plus y penser).
L’étude a montré que les participantes pensaient beaucoup plus à l’ours blanc quand on leur demande de ne pas y penser. Wegner en conclut que la tentative de supprimer une pensée conduit à une intensification de celle-ci : cela s’appelle “l’effet rebond“.
Risque de création d’une obsession
Ilios Kotsou continue en écrivant qu’un bon moyen de se créer une obsession est de porter exagérément attention à toutes ses pensées et d’en débusquer une qui nous rend honteux (“je ne devrais pas avoir cette pensée, pourquoi je n’arrive pas à la maîtriser, je fais tout pour la contrôler mais je n’y arrive pas”…).
Or la honte comporte des dangers pour notre santé mentale :
- la honte, c’est s’assigner l’étiquette « je suis mauvais.e » (plutôt que séparer identité “je suis nul.le” et action “j’ai fait ci/ ça”);
- la honte a un pouvoir destructeur pour soi et les autres parce que la douleur engendrée par la honte rend plus susceptible de s’engager dans des comportements autodestructeurs ou d’agresser et d’infliger de la honte aux autres;
- la honte érode le courage et alimente la démotivation.
Être obsédé par une pensée, c’est se persuader qu’il est terrible d’avoir cette pensée, qu’elle est vraiment indésirable et qu’elle doit absolument disparaître pour ne pas avoir de conséquences néfastes et ruiner notre journée, voire notre vie ! Mais, comme vu plus haut, supprimer nos pensées n’est pas si facile !
Là encore, Wegner a conduit une expérience pour valider ce mécanisme : il a demandé à une groupe de participants de choisir une personne de leur entourage avec la consigne de penser à ce qu’ils voulaient avant d’aller dormir, sauf à cette personne précisément. Un groupe de participants témoins n’avait pas cette consigne (il ne devait pas supprimer cette pensée). Au réveil, les participants devaient noter leurs rêves. Il est apparu que penser à la personne augmentait sa présence dans les rêves des membres des deux groupes, mais cette effet est exacerbé par le fait d’essayer de ne pas y penser !