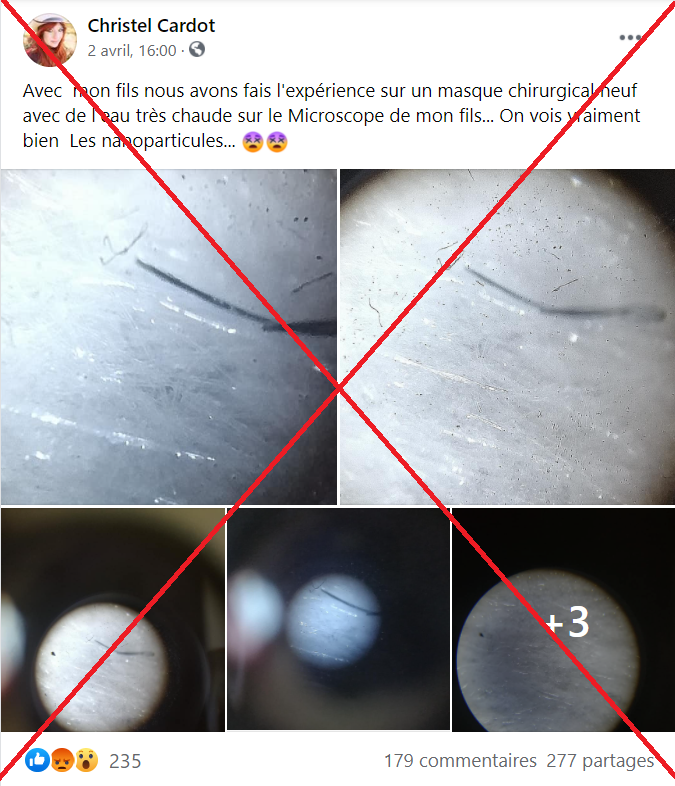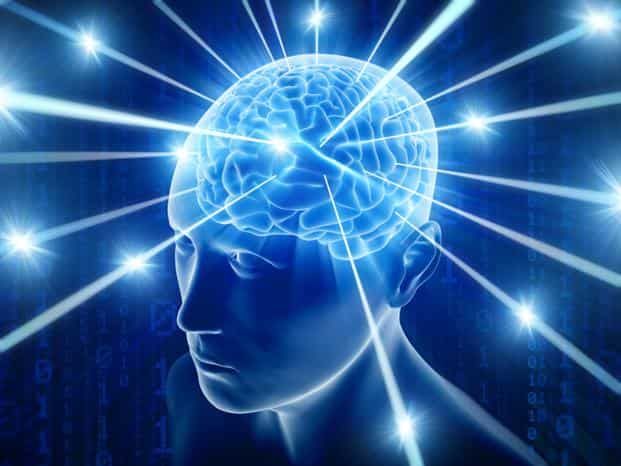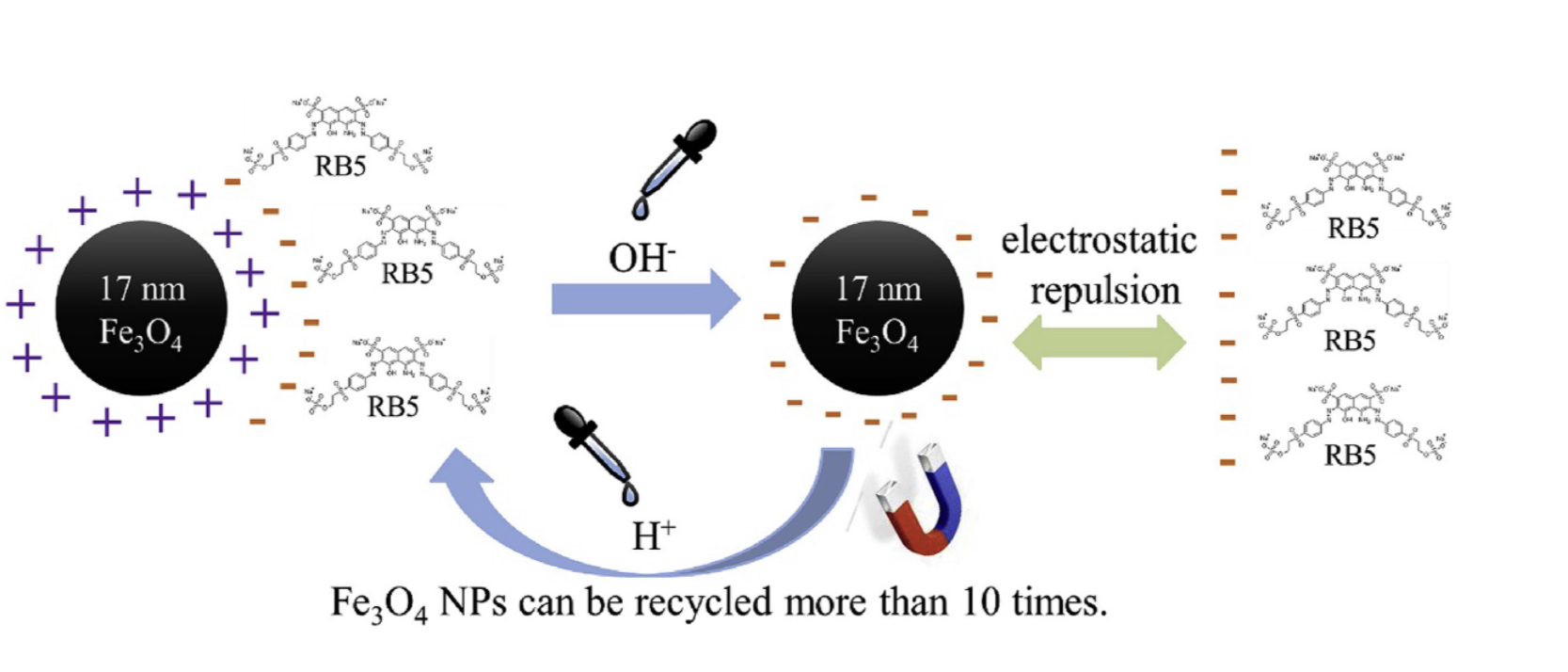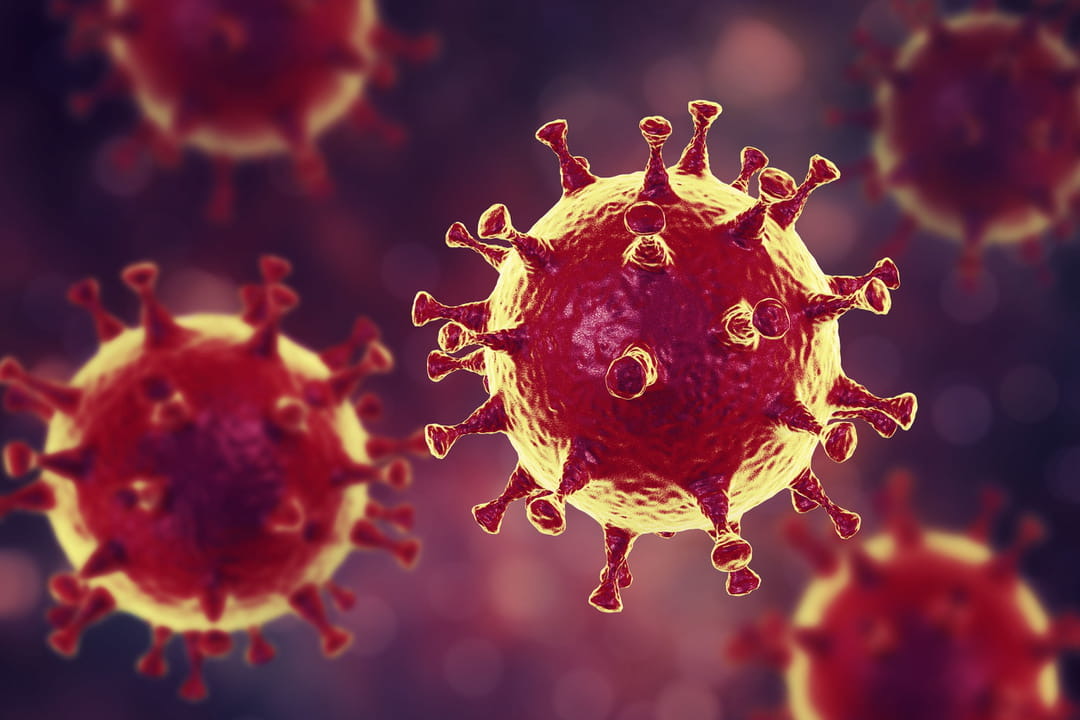Bataille autour du cerveau virtuel à 1 milliard d’euros
Le projet HBP – pour « Human Brain Project » – est le plus ambitieux des travaux de reconstitution du cerveau humain. Financé par l’Europe, il inspire pourtant la colère de nombreux neuroscientifiques.
Créer un cerveau synthétique : c’est la promesse vertigineuse du « HBP »Human Brain Project. Il s’agit rien de moins que de reconstituer, sur des circuits de silicone, l’intégralité du fonctionnement d’un cerveau humain.
Lancé l’an dernier, HBP, qui fait l’objet d’un financement européen de 1,2 milliard d’euros sur dix ans, est l’initiative la plus ambitieuse au monde en vue de percer les mystères cachés sous nos crânes.
Ses concepteurs en attendent des retombées énormes pour la médecine ou l’intelligence artificielle.
Un projet phare, donc. Et pourtant, plus de 300 neuroscientifiques européens de haut niveau disent « stop ». Ils ont la conviction qu’il est mal emmanché, et que tout cet argent pourrait être bien mieux utilisé. Ils viennent de lancer un appel au boycott, espérant pousser la Commission européenne à une révision radicale.
Selon eux, le patron du HBP, Henry Markram, se conduit comme un autocrate, après avoir vendu un rêve impossible aux médias et aux politiques. Un des signataires, Jean-René Duhamel (CNRS) explique :
« Reproduire le fonctionnement du cerveau humain dans les dix ans est complètement utopique, le cerveau est bien trop complexe. Le précédent projet, Blue Brain Project, financé par IBM, n’a permis de reconstituer qu’une colonne corticale. »
Tout ce que peut faire le HBP, c’est esquisser une architecture du cerveau à partir des données déjà connues.
Un autre chercheur en neurosciences, qui ne veut pas être cité, est plus sévère encore :
« Il y a entre 10 et 100 milliards de neurones dans notre cerveau, et entre 10 000 et 100 000 milliards de connexions. Faire croire qu’on va reproduire un cerveau, puis qu’on va l’allumer comme un ordinateur, est malhonnête. Même si on y arrivait un jour, une telle modélisation n’aiderait pas forcément à comprendre comment fonctionne le cerveau.
Si des physiciens qui cherchaient à comprendre les lois de la thermodynamique avaient modélisé un gaz, avec chacun de ses atomes, ils auraient certes obtenu l’image d’un gaz sur leur ordinateur, mais ils n’auraient toujours rien compris à ces lois. »
Une fronde de neuroscientifiques
Ce qui coince, c’est la place – ou plutôt l’absence de place – dévolue dans le projet aux études neuroscientifiques expérimentales. Dès le départ, Henry Makram a annoncé que le projet ne consistait pas à faire avancer cette recherche-là, mais à créer un outil à partir de toutes les données collectées au cours des trente dernières années.
Froissés, de nombreux labos neuroscientifiques ont refusé de participer. Beaucoup considèrent qu’il est prématuré de vouloir reproduire un cerveau, jugeant que la recherche n’est pas assez avancée.
Une partie d’entre eux, conduits par Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, a toutefois accepté d’y participer, rêvant de faire bouger les choses de l’intérieur. Ils ont créé une section « architecture cognitive » que Dehaene a accepté de coordonner. A l’origine, il se montrait plutôt enthousiaste : « C’est un très grand défi de simuler une architecture de cette nature », se réjouit-il dans la vidéo ci-dessous.
« Nous fabriquons une machine »
Quand il parle de son projet, il parle de puzzle ou de « machinerie » construite pièce par pièce :
« Nous fabriquons une machine. Et pour la première fois de l’histoire, toutes les disciplines participent à un projet : médecins, neuroscientifiques, physiciens, biologistes, informaticiens, bio-informaticiens, mathématiciens, statisticiens, chimistes, éthiciens, philosophes… Cela ne s’est jamais vu ! »
Quand je lui demande dans combien de temps il pense qu’il sera possible de modéliser entièrement le fonctionnement d’un cerveau humain, il élude :
« La simulation d’un cerveau humain, ça n’est qu’un objectif qu’on a fixé à 2023. Mais ce qui est plus important, c’est de bâtir l’outil nécessaire pour atteindre cet objectif. Comment regrouper, organiser, analyser les données. Comment bâtir le modèle d’un neurone, d’un synapse, d’une région du cerveau ? Toutes ces modèles bénéficieront à tous. »