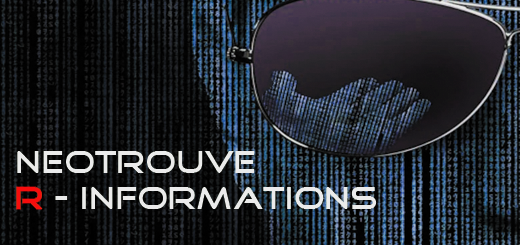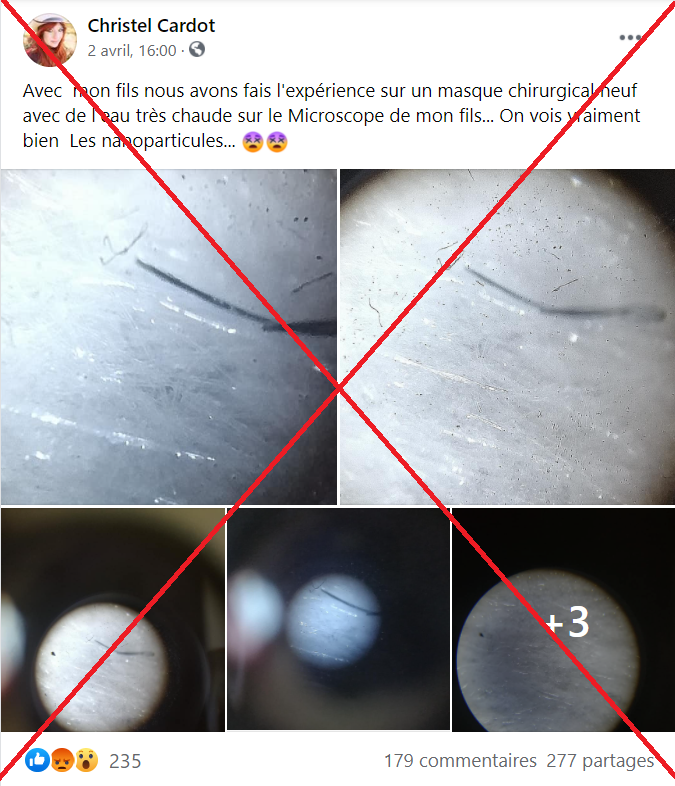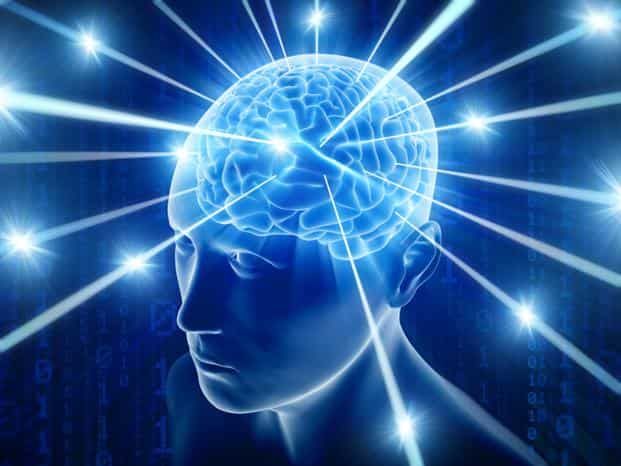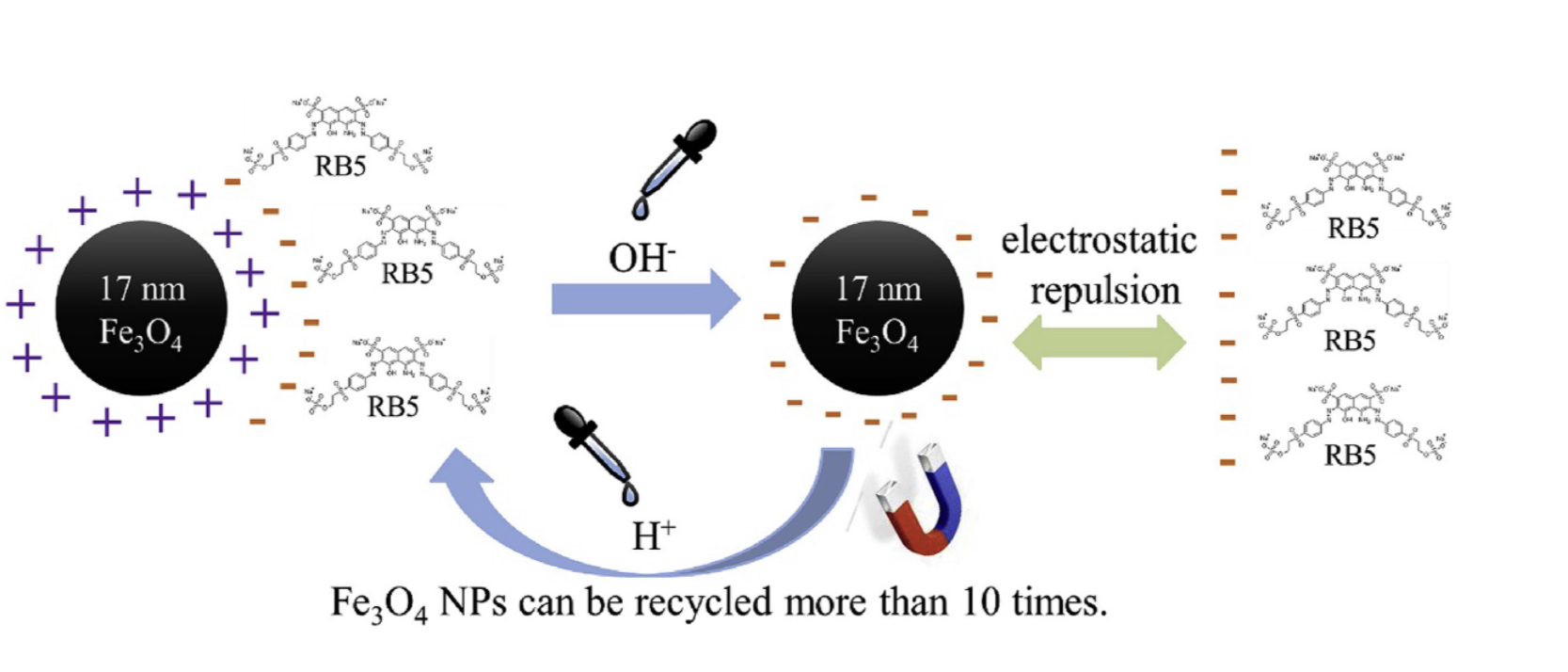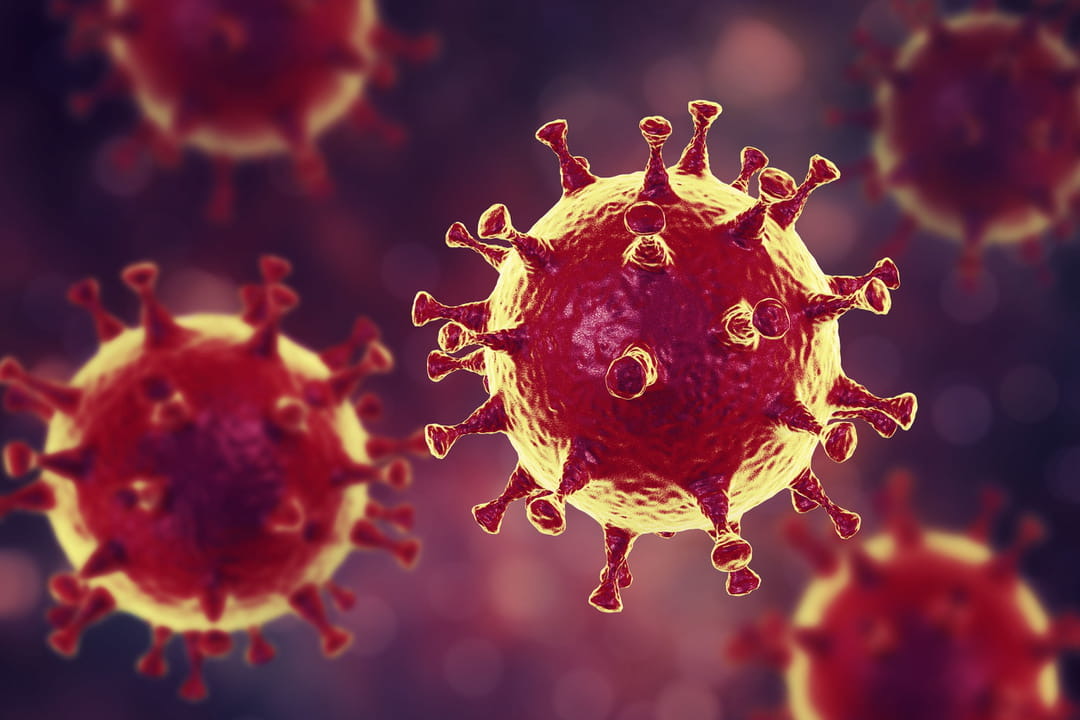150 individus: la taille maximale des groupes humains
 [Un article de Sciences Etonantes] Combien avez-vous d’amis ? Attention, je n’ai pas dit «d’amis sur Facebook», je parle des vraies relations ! Je vous laisse faire le compte, mais d’après Robin Dunbar, probablement pas beaucoup plus que 150.
[Un article de Sciences Etonantes] Combien avez-vous d’amis ? Attention, je n’ai pas dit «d’amis sur Facebook», je parle des vraies relations ! Je vous laisse faire le compte, mais d’après Robin Dunbar, probablement pas beaucoup plus que 150.
Dans les années 90, cet anthropologue a en effet suggéré que, chez l’homme comme chez les primates, la taille du cerveau impose une limite sur la taille maximale des groupes d’individus. Et tout ça en partant d’une question simple : à quoi nous sert un cerveau si gros ?
Le cerveau : un organe social ?
Une des traits qui caractérisent les primates, c’est le fait qu’ils possèdent un gros cerveau. En tout cas comparativement à leur taille : songez par exemple que chez l’autruche, la taille du cerveau ne dépasse pas celle des yeux !
Or le gros cerveau des primates est en partie un paradoxe, car s’il ne représente que 2% de la masse corporelle, il consomme 20% de l’énergie de nos organismes ! On peut donc légitimement se demander ce qui a fait, au cours de l’évolution des primates, que sa taille ait pu croître autant.
L’hypothèse naturelle, c’est qu’un gros cerveau augmente les capacités cognitives, et donc donne aux primates un avantage direct pour survivre dans l’environnement auquel ils sont confrontés. C’est l’hypothèse dite “écologique”.
Mais au début des années 90, R. Dunbar a choisi d’étudier une piste différente : notre cerveau aurait grossi avant tout pour des raisons sociales. Un plus gros cerveau permet aux primates de former des groupes sociaux plus gros, et c’est ça qui leur donne indirectement un avantage dans leur environnement. C’estl’hypothèse dite du cerveau social.
 Parfois, c’est la taille qui compte
Parfois, c’est la taille qui compte
Pour tester l’hypothèse du cerveau social, Dunbar a décidé d’estimer chez les primates les corrélations qui existent entre la taille des groupes et la taille du cerveau [1].
Plus précisément, il s’est intéressé à la taille du néocortex (voir ci-contre), car cette partie du cerveau est le siège des fonctions cognitives supérieures. Le néocortex s’est développé tardivement au cours de l’évolution, et il est particulièrement important chez les primates, au contraire de beaucoup des autres mammifères (sans parler des amphibiens, qui n’en ont même pas).
Et voici le résultat principal de Dunbar : la figure ci-dessous (tirée de [2]) vous montre pour différentes espèces de primates la taille typique du groupe social (en nombre d’individus) en fonction du ratio néocortical, c’est-à-dire le volume du néocortex divisé par le volume du reste du cerveau. En vert, j’ai ajouté à titre d’exemple le détail pour le cas précis de ce sympathique singe, appelé “nasique” :
Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le ratio néocortical se corrèle bien avec la taille des groupes ! Cette analyse va dans le sens de la confirmation de l’hypothèse du cerveau social : un gros cerveau nous permet de vivre en groupes organisés plus grands.
 L’homme, un primate parmi d’autres
L’homme, un primate parmi d’autres
Évidemment dans ce raisonnement, il est tentant d’extrapoler au cas de l’homme. Et c’est ce qu’a fait Dunbar [3] ! Notre néocortex fait en moyenne 1000cm3, pour un cerveau total d’environ 1250cm3, soit un ratio néocortical proche de 4. En mettant ce chiffre dans la régression de Dunbar, on obtient comme taille de groupe : 150 individus.
Pour vérifier a posteriori si ce nombre magique de 150 personnes avait un sens pour les humains, Dunbar a cherché à analyser la taille des groupes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs (comme les San du Botswana, voir ci-contre).
Il s’agit en effet des peuples qui ont conservé la structure sociale la plus proche de ce qu’elle pouvait être chez nos ancêtres préhistoriques. Comme on s’en doute, il a calculé que la taille des villages chez divers peuples de chasseurs-cueilleurs d’Australie, Nouvelle Guinée, Amérique, etc., donnait une moyenne de 148 individus [3].
Le langage à la rescousse
Vu de nos sociétés modernes, une limite à 150 personnes, ça peut paraître assez peu. Surtout quand on sait qu’un cerveau humain peut reconnaître typiquement 1500 visages. Mais d’après Dunbar, ce qui compte pour la cohésion d’un groupe n’est pas seulement de bien connaître chaque personne, mais aussi de correctement percevoir les interrelations entre personnes, du genre « Est-ce que Machine s’entend bien avec Truc ? ». Et ça, c’est beaucoup plus difficile car la quantité d’informations à mémoriser augmente comme le carré de la taille du groupe !
La solution partielle à cette limitation, c’est le langage ! En effet si aujourd’hui nous sommes capables de former des groupes sociaux immenses (à l’échelle d’une nation), c’est bien grâce au langage. C’est lui qui nous permet d’après Dunbar de briser la limite des 150, et de conserver une certaine cohésion sociale sur des groupes beaucoup plus grands, notamment parce qu’il permet de véhiculer des informations sur les personnes sans avoir à être contact direct.
Les applications du nombre de Dunbar
Au cours de son investigation, Dunbar a pu noter que le chiffre magique de 150 se retrouve naturellement dans nos organisations : ainsi dans de nombreux corps d’armée, il existe des divisions d’unités militaires dont la taille est typiquement de 100 à 200 personnes, censée être d’après Dunbar la taille maximum pour conserver une cohésion de groupe suffisante. Il s’agit typiquement de la compagnie dans les armées modernes, ou de la centurie dans la légion romaine.
De la même manière, le génial journaliste Malcolm Gladwell rapporte dans son livreThe Tipping Point que la société Gore-Tex (qui produit le fameux tissu) a pour règle absolue de limiter la taille de ses sites à 150 personnes. Dès qu’ils dépassent ce chiffre, ils coupent l’effectif en deux et reconstruisent une nouvelle usine un peu plus loin.
Une idée à méditer, je m’en vais de ce pas proposer à mon chef de découper mon labo de recherche en trois…
[1] R.I.M Dunbar, Neocortex size as a constraint on group size in primates, Journal of Human Evolution 20 (1992) p469
[2] R.I.M Dunbar and S. Shultz, Evolution in the Social Brain, Science 317 (2007) p1344
[3] R. I. M. Dunbar, Coevolution of neocortical size, groupe size and language in humans, Behavioral and Brain Sciences 16 (1993), p681