La mondialisation de la psychiatrie
[Courrier International 4/3/2010] En ces temps de mondialisation, nous devrions être sensibles aux différences locales et y attacher de la valeur. Et savoir que toutes les cultures n’ont pas la même conception de la psychologie humaine est crucial dans l’approche de la santé et de la maladie mentale. Ainsi, un Nigérian peut souffrir d’une forme de dépression propre à sa culture, qu’il décrira par une sensation de brûlure dans la tête, alors qu’un paysan chinois parlera simplement de douleurs à l’épaule ou à l’estomac. Et une étude auprès de réfugiées salvadoriennes traumatisées par une longue guerre civile a montré que certaines d’entre elles ressentaient ce qu’elles appellent des calorías, une sensation de chaleur corporelle intense.
Les psychiatres et les anthropologues médicaux qui étudient la maladie mentale dans différentes cultures ont constaté depuis longtemps que les troubles mentaux n’étaient pas uniformément répartis dans le monde et ne se manifestaient pas partout de la même façon. Malheureusement, aux Etats-Unis, pays qui domine le débat international sur la classification et le traitement des pathologies, les professionnels de la santé mentale font souvent peu de cas de ces différences. Pis, les pathologies mentales (l’état de stress posttraumatique (ESPT), l’anorexie, la schizophrénie et la dépression) s’uniformisent à un rythme vertigineux.
Cette classification des diagnostic a bien sur un rapport avec le traitement envisagé et c’est la qu’interviennent les laboratoires pharaceutiques.
Par exemple, le marché japonais posait à GSK un problème extrêmement difficile. Certes, il existait bien au Japon un diagnostic clinique de la dépression (utsubyo), mais il ne ressemblait en rien à la version américaine : il décrivait une pathologie aussi dévastatrice et aussi stigmatisante que la schizophrénie, et rare de surcroît, ce qui compromettait les perspectives commerciales des antidépresseurs au Japon. La plupart des autres états mélancoliques n’y étaient pas considérés comme des maladies. Pour que la paroxétine soit un succès, il ne suffisait donc pas d’accaparer le marché restreint des Japonais à qui l’on avait diagnostiqué une utsubyo. Il fallait modifier l’idée qu’on se faisait de la dépression dans le pays.
GSK est ajourd’hui manifestement parvenu à ses fins. En présentant la dépression comme un kokoro no kaze (“un rhume de l’âme”), le laboratoire a réussi à généraliser le diagnostic. L’année qui a suivi le lancement de la paroxétine sur le marché japonais, les ventes ont rapporté 100 millions de dollars.
La dépression et l’état de stress posttraumatique ne sont pas que des listes de symptômes. De même que l’hystérie était un trouble du xixe siècle par excellence, l’ESPT et la dépression en disent long sur la représentation de soi aux Etats-Unis et ailleurs en Occident. Ces deux affections contiennent des présupposés sur les événements susceptibles d’entraîner des troubles mentaux et sur ce qui distingue les états psychologiques normaux des états pathologiques. Elles sont bien plus qu’un ensemble de symptômes : avec elles, c’est une vision du monde que nous exportons.

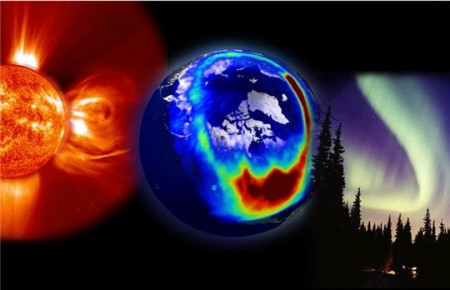

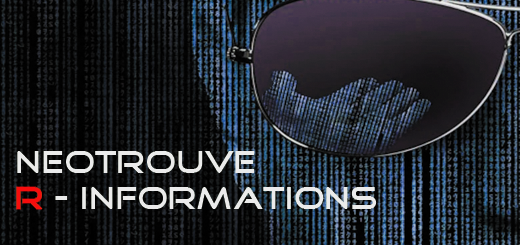




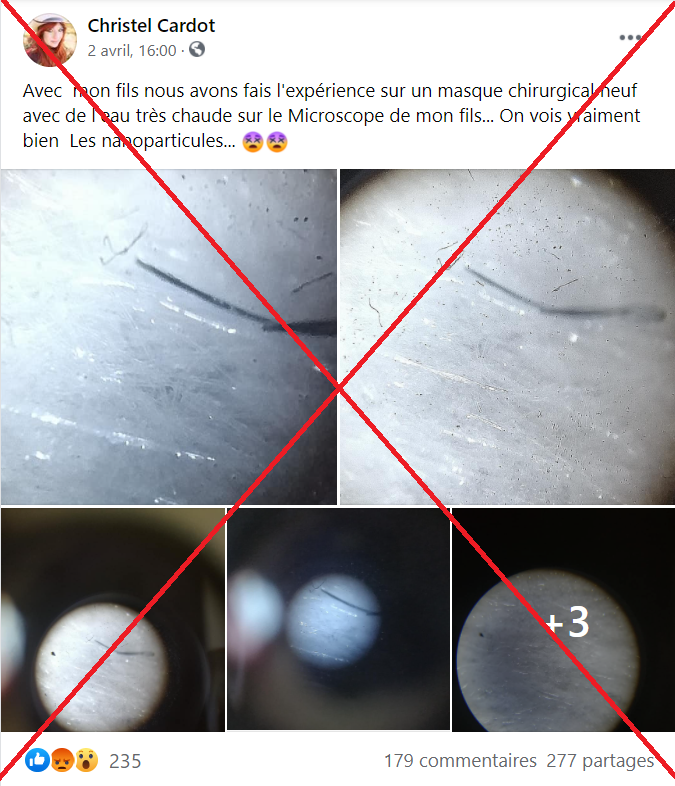
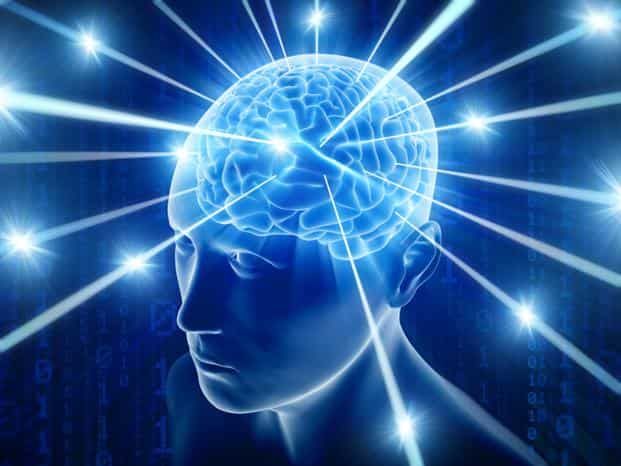


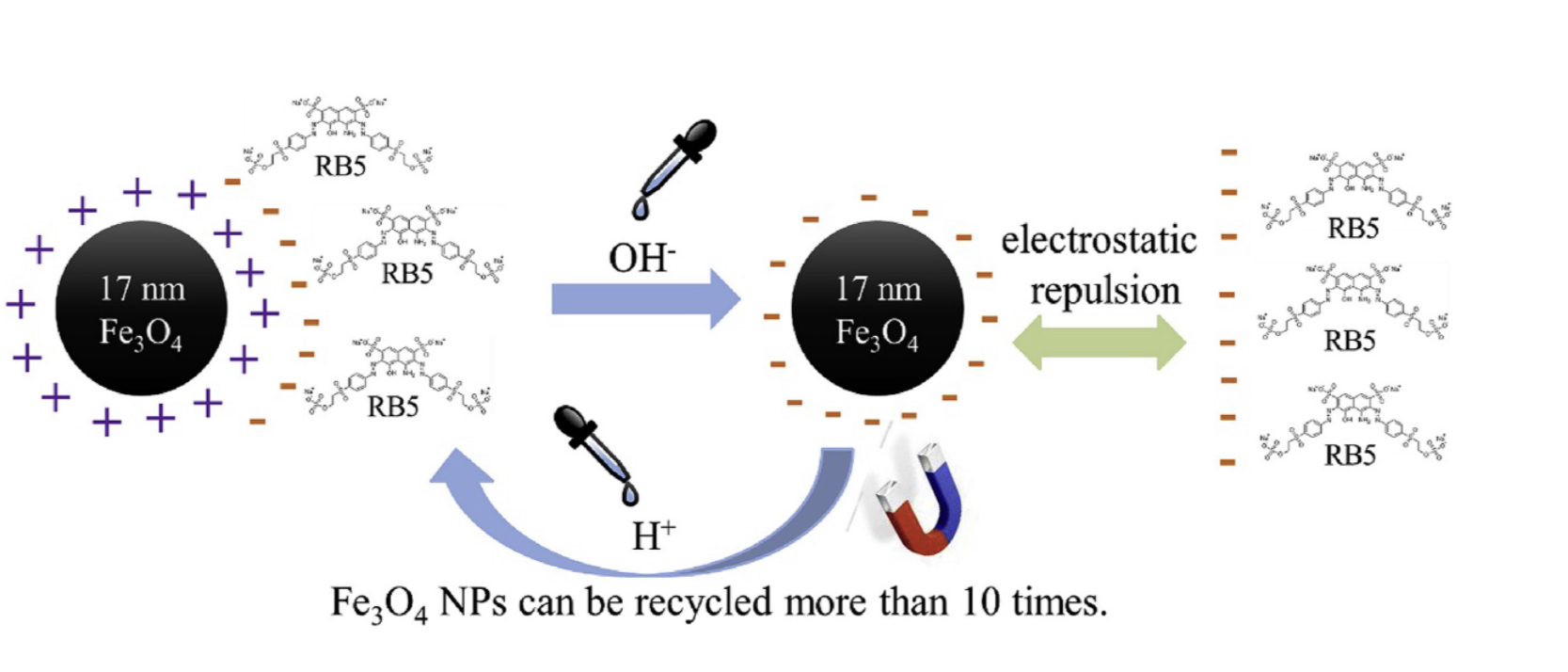


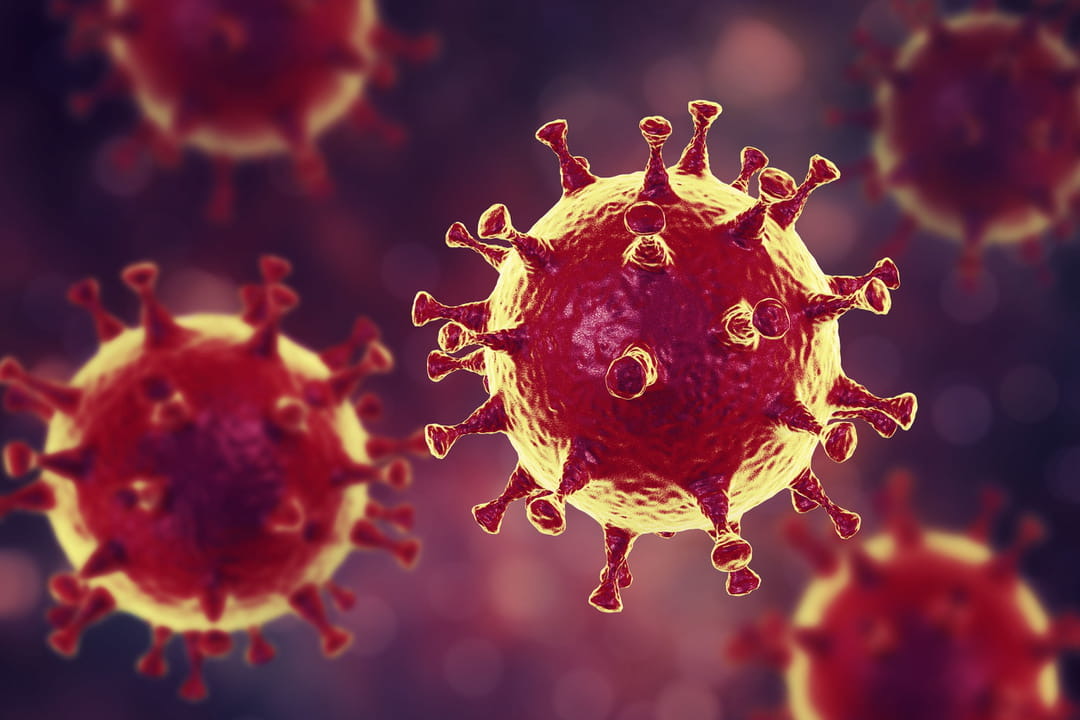

C’est l’homme malade qui regarde l’homme malade. Le malade qui ne veut pas admettre qu’il l’est, face à l’autre en qui il voit une simple maladie, une occasion pour s’enfoncer dans son profit.
Il n’est pas nécessaire de voyager dans le monde pour constater que des groupes d’individus ou des individus isolés parlent de les maux psychologiques de manières différentes. La même pathologie sera décrite en fonction de la subjectivité propre à un milieu social, un milieu éducatif, voire même des croyances religieuses, une adhésion à un mouvement culturel ou un arrière fond politique. Par ailleurs le niveau culturel, l’intelligence, la capacité de réfléchir à ce que l’on essaie de formuler, sont des paramètres déterminants dans la transmission de l’information. Mais ces caractéristiques de l’expression du mental humain sont systématiquement négligées au titre de la déontologie médicale qui impose de ne pas porter de jugements qualitatifs quand il est question de souffrance humaine.
Que les américains aient une volonté d’homogénéisation de la symptomatologie psychiatrique ne devrait pas poser de problème si l’intention était de disposer d’un langage commun aux médecins. Le problème est que l’écueil inévitable réside dans la tentation de l’apprendre aussi aux malades, de façon à rendre intelligible et universel le propos. Et dans cette perspective, les laboratoire n’ont pas beaucoup de travail à faire, ce sont les flux culturels qui s’en chargenet. Désormais les adolescentes pensent, éprouvent, exigent, ambitionnent d’une même et seule voix (voie) à travers le monde télévisuel. En revanche, la où les laboratoires sont immédiatement condamnables dans leurs objectifs commerciaux, c’est de grossir les chiffres statistiques de types pathologiques habituellement faibles ou marginaux, comme l’ex « psychose maniaco-dépessive » rebaptisée dans la nomenclature anglo-saxonne, sans doute pour faire moderne: Trouble Bipolaire, par ailleurs décrits en sous-catégories qui permettent d’affiner et justifier la prescription de médicaments dits normothymiques (régulateurs de l’humeur). Ces troubles maniaques et dépressions particulières sont rares, mais à en croire les données des laboratoires il existerait une masse considérable de cas non diagnostiqués. Ce qui fait que l’on assiste depuis quelques années, a des diagnostics intempestifs de Troubles Bipolaires par des médecins généralistes et même des psychiatres, peu aguerris à l’observation de ces troubles et pour cause, au moindre cas d’activité psychique sortant de l’ordinaire ou lors d’une récurrence de manifestation dépressive; le plus gros contingent de ces erreurs de diagnostic concernant des sujets présentant une structure de personnalité hystérique. (Organisation psychique très répandue dans la population générale, qui laisse entrevoir durablement le maintien de ce transfert nosologique abusif.)
Il faut croire alors et en effet, que les enjeux commerciaux, dans ce cas précis de Troubles Bipolaires du moins , l’emporte nettement sur la réalité clinique de leur prévalence.