Ils ont observé l’effet de l’argent sur des singes
En 2005, un psychologue et un économiste ont enseigné un groupe de singes capucins le concept de l’argent et la monnaie.
Vous avez peut être pensé que la monnaie ou l’argent sont des concepts propres l’homme car jusque là aucune forme de négociation avec une quelconque forme de monnaie n’avait pu être observé entre animaux.
Ce duo économiste / psychologue de l’Université Yale en 2005, a réussi à enseigner à sept singes capucins comment utiliser l’argent.
Les chercheurs ont essayé d’exploiter et d’expérimenter avec succès après avoir enseigné aux capucins comment acheter des raisins, des pommes… L’économiste a voulu étudier qu’est ce qui incitait les singes à se comporter d’une manière ou d’une autre, tandis que le psychologue a analysé le comportement des singes et les conclusions de cette étude ont été surprenantes. On a put mettre en évidence comment la négociation tarifée à propos de nourriture pouvait engendrer un comportement irrationnel….
Contrairement à ce qui est fréquemment supposé en science économique, l’être humain se comporte bien souvent de façon irrationnelle. De nombreuses expériences mettent en évidence notre irrationnalité, mais bien peu cherchent à expliquer son origine.
Dans cette veine, des chercheurs de l’Université de Yale se sont demandés si notre irrationnalité humaine était de nature culturelle (et donc acquise), ou bien d’origine biologique (et donc innée). Pour tenter de répondre à cette question, ils ont analysé les choix économiques…d’une colonie de singes !
Et ces derniers se révèlent tout aussi faillibles que nous !
Monnaie de singe
Le Laboratoire de Cognition Comparée de Yale est spécialisé dans l’étude du comportement des singes capucins. Ces derniers sont des singes vivant en Amérique du Sud, et qui sont séparés de l’être humain par près de 35 millions d’années d’évolution. Afin de tester si ces singes pouvait comme nous se comporter de manière irrationnelle, K. Chen et ses collaborateurs ont organisé avec eux des expériences de nature économique.

Pour cela, ils ont d’abord introduit une monnaie, sous la forme de petits disques métalliques. Puis ils ont fait comprendre aux singes qu’ils pouvaient échanger avec les humains leurs disques contre de la nourriture, par exemple des morceaux de pommes.
Une fois que les singes eurent bien compris le principe de l’échange avec un seul expérimentateur humain, les chercheurs introduisirent des situations plus compliquées, faisant intervenir des choix entre deux expérimentateurs proposant des possibilités différentes (comme ci-contre), et dont certaines peuvent comporter une part de hasard, et donc de risque.
Un cas simple où les singes sont rationnels
Dans une première expérience, on soumet les singes à la situation suivante. Ils ont la possibilité d’échanger une de leur pièce de monnaie avec deux expérimentateurs différents. Le premier expérimentateur (noté E1) propose un morceau de pomme, qu’il donne au singe si ce dernier choisit de faire l’échange. L’expérimentateur E2 propose également un morceau de pomme, mais si le singe choisit de faire la transaction, il lui offre un second morceau de pomme dans 50% des cas. Ce dilemme est résumé sur le diagramme ci-contre.
Bien entendu, pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour s’apercevoir que l’expérimentateur E2 est plus intéressant ! Et les singes s’en rendent vite compte puisqu’une fois leurs choix stabilisés, ils finissent par préférer E2 dans près de 85% des cas.
Le singe irrationnel : la dépendance à la référence
Dans une seconde expérience, Keith Chen et son équipe [1] ont proposé à leurs capucins le choix représenté ci-contre :

L’expérimentateur E1 propose un seul morceau de pomme, alors que E2 en affiche deux. Mais si le singe choisit E2, ce dernier retire un des deux morceaux et n’en donne qu’un seul. Au final, le hasard n’intervient pas, les deux choix sont strictement équivalents, mais la présentation est différente.
Si notre singe était rationnel, il choisirait indifféremment E1 ou E2, puisque le résultat est le même. Mais ce qu’on observe, c’est qu’il va choisir E1 dans 80% des cas ! On peut expliquer ce phénomène (qu’on retrouve aussi chez l’être humain) par la volonté qu’a le sujet d’éviter le sentiment de perte, provoqué par le fait de se voir retirer un des deux morceaux initialement promis.
C’est ce qu’on appelle la dépendance à la référence, car la manière dont on juge le résultat final (l’obtention d’un morceau de pomme) dépend de ce qu’on prend comme point de départ (l’affichage initial de 1 ou 2 morceaux suivant E1 ou E2). Il faut bien voir ce que ce résultat a de contre-intuitif le cas d’un animal, car choisir E1 oblige le singe a réfréner ses pulsions naturelles, qui le pousseraient à se jeter sur l’expérimentateur E2 qui affiche une quantité plus importante au départ.
La référence à la dépendance est un cas d’irrationnalité, car elle nous conduit à faire une différence de traitement entre deux situations pourtant identiques, mais présentées différemment. Mais il y a pire : ce phénomène peut nous conduire à carrément modifier nos choix pour des simples questions de présentation



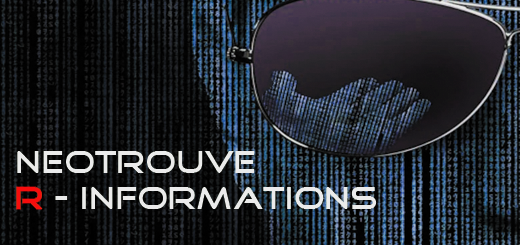





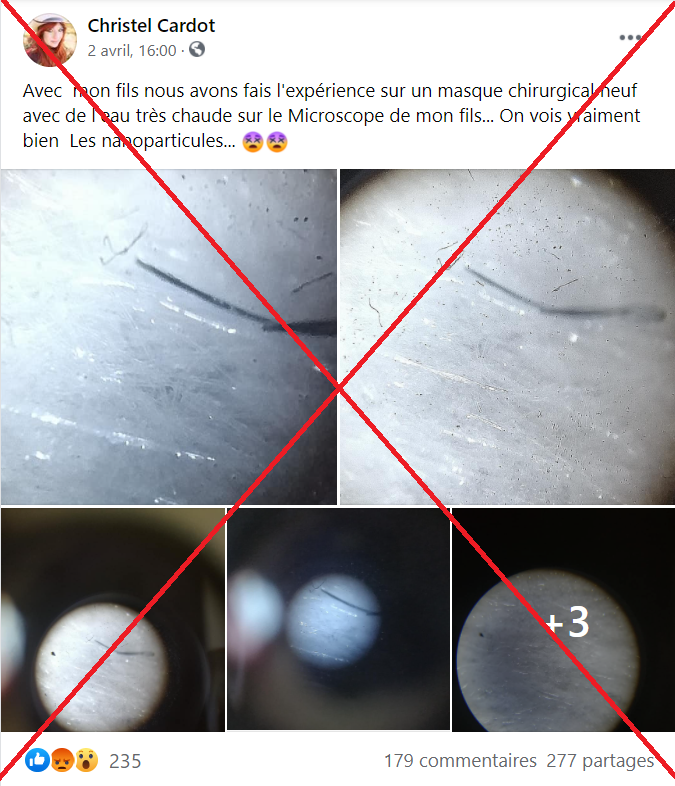
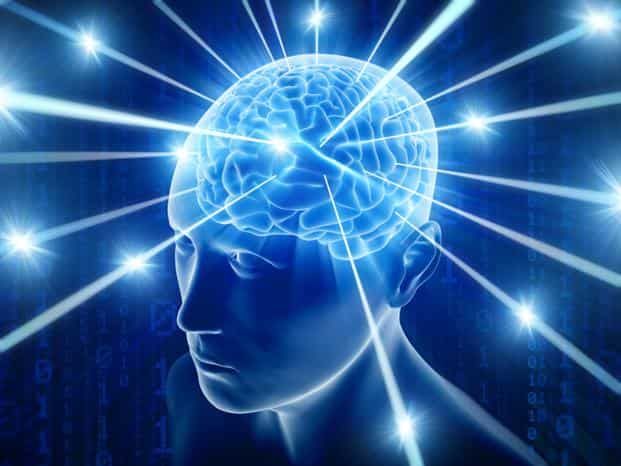


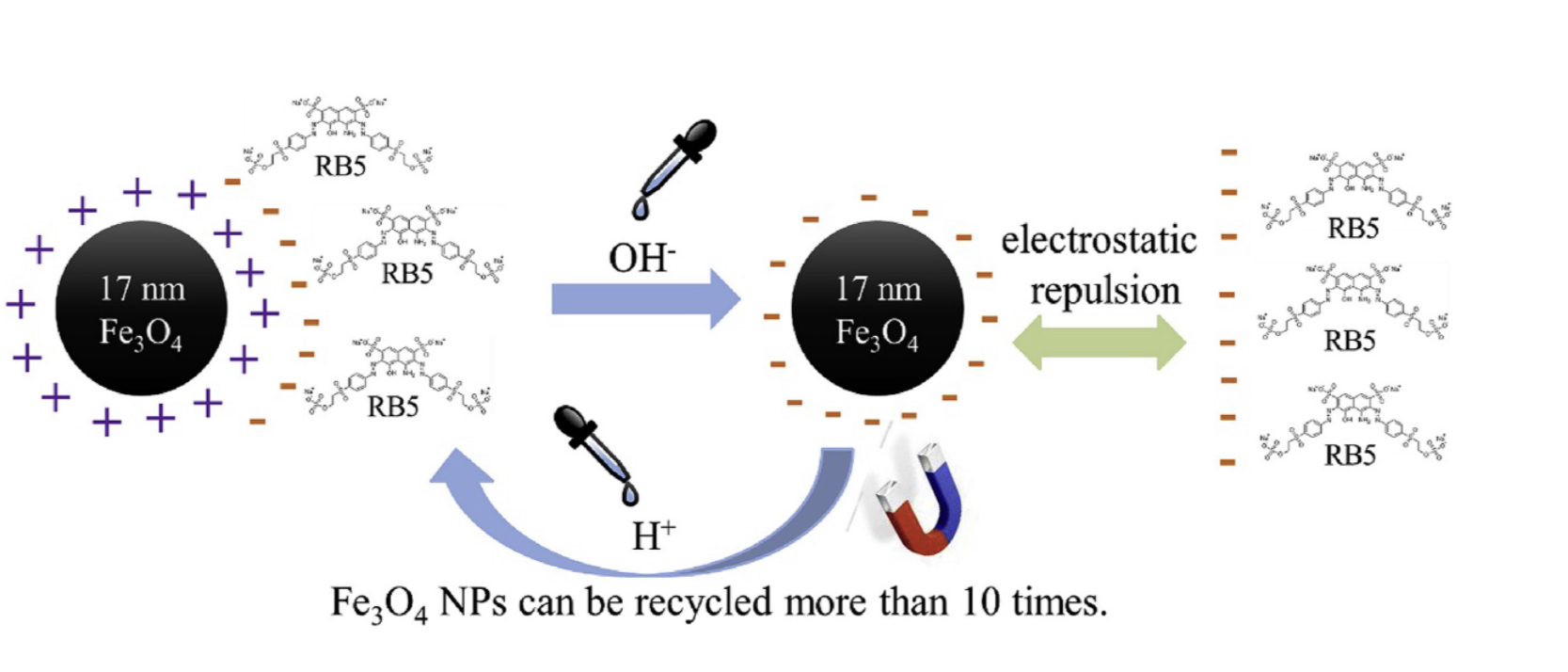


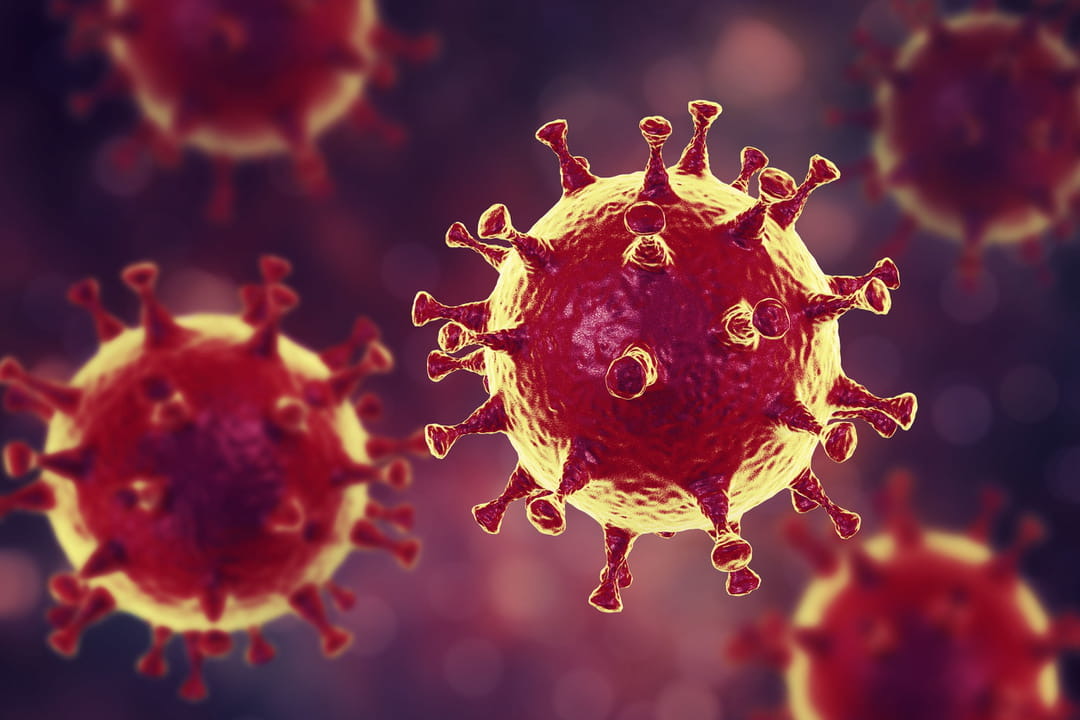

Dans le cas d’un humain on pourrait dire aussi que dans la deuxième situation, il choisit E1 parce qu’il le traite avec plus de respect.
zhaan »
Ta réponse est très bien placer,j’adore ^^
c’est bien l’expérimentateur qui est irrationnel considérant que la malhonnêteté E2 est égale à l’offre honnête E1 . Ainsi donc les « psy » considère le vol (offre non conforme à la livraison) comme un choix rationnel . Continuez à donner votre fric à ces bouffons de parasites.